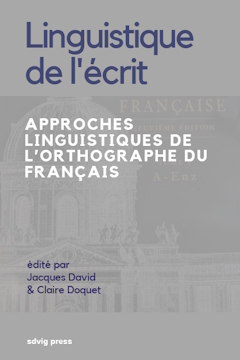1 | Introduction
1Dans les discussions – souvent passionnées – sur l’éventualité d’une réforme de l’orthographe française, l’histoire est régulièrement convoquée à titre d’argument. Elle-même jalonnée de « batailles » (Catach 1985) et de « querelles » (Arrivé 1994), l’histoire de l’orthographe a partie liée non seulement avec les enjeux de la réforme orthographique, mais aussi avec les débats sur son enseignement, ainsi qu’avec les recherches scientifiques dans ce domaine, à la croisée de l’histoire de la langue française et des théories de l’écriture. Pourtant, les fondements de ces connaissances sont rarement interrogés en tant que tels : depuis quand, par qui, selon quels principes méthodologiques et avec quelles visées les savoirs en histoire de l’orthographe ont-ils été élaborés ?
2À partir d’un corpus composé de onze monographies et ouvrages collectifs ainsi que d’un article, tous publiés entre 1867 et 20231, il s’agit d’analyser les facteurs de continuité et de rupture, d’unité et de diversité de ces travaux afin de dégager les enjeux qui sous-tendent le développement de l’histoire de l’orthographe, qu’ils soient sociaux ou conceptuels, en s’intéressant particulièrement aux relations entre histoire de l’orthographe et théorisations de la langue écrite et des relations entre oral et écrit, du XIXe siècle à nos jours. Ce corpus est analysé d’un double point de vue. Une analyse « externe » permet d’identifier les auteurs et leur statut, ainsi que les genres de discours dans lesquels s’inscrivent ces textes, du compte rendu aux ouvrages de vulgarisation en passant par les thèses, notamment. Une analyse « interne » vise à les confronter sur la base de critères tels que la périodisation de l’histoire de l’orthographe proposée, les sources exploitées et les objectifs fixés. On mettra ainsi en lumière les enjeux propres à l’élaboration et à la diffusion des savoirs en histoire de l’orthographe.
3Le plan suivi pour présenter les résultats de ces analyses est chronologique. En effet, trois grandes périodes structurent l’évolution des travaux relevant de l’histoire de l’orthographe française entre 1867 à 2023. Dans un premier temps, de la fin des années 1860 à la première décennie du XXe siècle, elle commence à être envisagée en tant qu’objet d’étude en soi, sans pour autant devenir un champ de recherche spécialisé. C’est au cours du XXe siècle que le domaine prend son autonomie par rapport à la philologie et à l’histoire de la langue française pour devenir une spécialité qui suscite à la fois des thèses et des travaux collectifs recherchant les régularités du système orthographique propre à chaque époque et proposant des clés explicatives de cette évolution. Enfin, depuis les années 2000, l’histoire de l’orthographe a connu deux tendances complémentaires au moment où les rectifications orthographiques de 1990 continuent à faire débat : l’une tend à vulgariser ce savoir auprès du grand public, l’autre a pour but de former étudiants et enseignants.
2 | Un objet d’étude aux contours flous (1867-1910)
2.1. Un premier regard rétrospectif sur l’orthographe française : Ambroise Firmin-Didot (1867)
4En mai 1868, la célèbre dictée « de Mérimée » fait date à la cour impériale. Signe que l’orthographe est devenue une pratique sociale et un enjeu national, elle représente l’« aboutissement » d’un mouvement de revendication à la fois savant et populaire en faveur de sa réforme (Portebois 2006). Or le débat à ce sujet est au même moment relancé par la préparation de la septième édition du Dictionnaire de l’Académie française, qui paraît finalement en 1878. C’est dans ce cadre que Firmin-Didot, imprimeur-libraire de l’Institut de France, publie en novembre 1867 un ouvrage intitulé Observations sur l’orthographe française : suivies d’un exposé historique des opinions et systèmes sur ce sujet, depuis 1527 jusqu’à nos jours (1867a), qu’il dédie « À Messieurs de l’Académie française ».
5Comme l’indique son titre, l’ouvrage comprend deux parties. Il a pour but de pousser les Immortels à réformer l’orthographe dans la prochaine édition du Dictionnaire. Dans la première partie, l’auteur présente de façon détaillée des lettres de l’alphabet dont l’usage mériterait, selon lui, d’être modifié. Cependant, l’imprimeur-libraire introduit ainsi la seconde partie, c’est-à-dire l’exposé historique, qui compte le plus grand nombre de pages (près de 200 sur 253) :
À la suite de mes remarques personnelles, je crois devoir donner ici un exposé succinct des diverses tentatives et des appels incessants faits depuis trois siècles par des esprits distingués, et je dirai même par des amis du bien public, en faveur d’une réforme orthographique2. J’espère que ce travail offrira de l’intérêt, ne fût-ce que sous le rapport de l’histoire de notre langue, et qu’il aura quelque utilité. (Ibid. : 55)
6Firmin-Didot ne conçoit pas l’histoire de l’orthographe comme un objet de réflexion en soi : non seulement elle se confond tout à fait avec l’histoire de la langue française, mais tant son « intérêt » que son « utilité » restent à démontrer. De fait, il ne propose pas une histoire de l’orthographe à proprement parler. Il reproduit dans des « appendices » de longs passages de documents dans un empan chronologique allant du XVIe au XIXe siècle. Certains reflètent des pratiques orthographiques anciennes ; d’autres des avis émis sur l’orthographe et son éventuelle réforme (Tableau 1).
Tableau 1 : Plan de l’exposé historique dans
(Firmin-Didot 1867)
|
7Dès l’année suivante, Firmin-Didot publie une seconde édition du même ouvrage, « revue et considérablement augmentée », sous un titre légèrement différent : Observations sur l’orthographe ou ortografie française ; suivies d’une Histoire de la Réforme orthographique depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours (1868)4. Cette nouvelle édition témoigne à la fois de l’actualité brulante du sujet et du succès de l’ouvrage, comme le prouvent aussi les nombreux comptes rendus de la première édition reproduits dans la seconde.
2.2. De la rétrospection à l’histoire de l’orthographe : Gaston Paris (1868)
8En réaction à cet ouvrage, Paris publie dès juin 1868 un article dans le Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Alors philologue de 29 ans, il est déjà suppléant de son père, Paulin Paris, à la chaire de Langue et littérature françaises du Moyen Âge au Collège de France. Nouvellement nommé directeur d’études pour les langues romanes à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), il est aussi membre, depuis 1866, de la Société de Linguistique de Paris5 (Bergounioux 1996). Il donne aussi un cours sur « l’Histoire des sons de la langue française » dans le cadre des cours libres de la rue Gerson (Jorge 2022a). Il y traite de l’orthographe en tant qu’instrument essentiel pour le développement de la phonétique historique (Jorge 2022b)6. L’histoire de l’orthographe telle qu’il l’envisage s’inscrit donc pleinement dans le champ de la philologie7, surtout, de son volet linguistique.
9L’article est composé de deux parties : une première livraison compte 25 pages et se présente comme un compte rendu de la première édition de l’ouvrage de Firmin-Didot ; une deuxième livraison, de 35 pages, porte sur la seconde édition et paraît en septembre de la même année8. En dotant son article d’un titre propre, « De l’histoire de l’orthographe française », Paris s’affranchit dès l’abord à la fois du genre du compte rendu et du livre recensé. De fait, il réduit d’emblée l’ouvrage de Firmin-Didot à sa dimension historique :
On ne peut rien lire de plus intéressant, de plus instructif et de plus curieux que l’Exposé historique dont M. Ambroise Firmin Didot a fait suivre ses observations sur l’orthographe française9. (Paris 1868a : 322)
10Toutefois, l’approche historique de Paris est singulière. L’histoire de l’orthographe telle qu’il la retrace relève d’une perspective chronologique, sur un empan plus long que celui pris en compte par l’imprimeur-libraire, en raison de l’intégration du Moyen Âge (Tableau 2). Il en propose une périodisation fondée sur un découpage en époques possédant chacune une cohérence interne, liée aux discours sur l’orthographe qui s’y développent plutôt que sur les pratiques orthographiques individuelles.
|
Tableau 2 : Principaux thèmes abordés dans « De
l’histoire de l’orthographe française » (Paris 1868) 1ère livraison (1868a) : 25 pages
|
11Dans ce cadre, prendre pour origine l’époque médiévale, conçue comme une phase de dégradation progressive des rapports entre oral et écrit, de plus en plus éloignés, fait des discours sur la réforme orthographique non plus un point de départ en histoire de l’orthographe, mais plutôt un aboutissement. Paris – dans la lignée réformatrice « rétrograde » décrite par Cerquiglini (1997) – parvient ainsi à établir une analogie entre la situation de la fin du XVIe siècle et celle de la fin du XIXe siècle dans le domaine de l’orthographe, où s’opposent partisans d’une réforme rationnelle et radicale, selon lui inapplicable, et défenseurs de l’orthographe en vigueur malgré ses incohérences. La seconde approche est victorieuse, grâce au rôle majeur de l’Académie française, instance de décision et facteur de « desséchante centralisation » (Paris 1868a : 326). Pour autant, prendre position quant à la réforme orthographique contemporaine paraît secondaire au philologue qui, grâce à sa situation dans l’enseignement supérieur, se sent en droit de prendre ses distances par rapport à l’Académie française10. Il le formule de la façon suivante à la fin de la seconde livraison de son texte.
J’examinerai ces réformes, et je dirai ce que j’en pense ; mais d’abord, si le lecteur veut bien m’accompagner dans ce voyage un peu aride, je reviendrai sur mes pas pour suivre, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, l’histoire de l’orthographe en dehors de l’Académie. C’est pour ainsi dire, à côté de l’histoire réelle que je viens de retracer rapidement, l’histoire idéale de l’orthographe française ; c’est le récit – très-sommaire – des essais de perfectionnement, des plans philosophiques, des utopies même, qui se sont produits en si grand nombre à ce sujet. (Paris 1868b : 507)
12Paris se projette ainsi vers la suite de la réflexion à mener : alors qu’il ne s’est intéressé qu’à l’orthographe qui s’est imposée, il lui reste à examiner les systèmes orthographiques qui ont été proposés sans être appliqués afin d’en faire une véritable histoire. Pour cela, il estime qu’on ne peut se contenter d’exposer successivement les points de vue ou les pratiques orthographiques d’auteurs différents ; il convient d’en faire un récit contextualisé.
13La distinction entre « histoire réelle » et « histoire idéale » de l’orthographe française sert à déplacer la focale vers d’autres directions de réflexion possibles. Elle contribue à nourrir intellectuellement le débat sur la réforme orthographique, dont la complexité ne peut être appréhendée qu’avec des connaissances approfondies. G. Paris conclut : « le doute est le commencement de la sagesse. Il en est peut-être aussi la fin, mais pas en orthographe, où je crois fermement qu’il y a une vérité11. » (Ibid.) Le savoir historique est la condition indispensable à l’affirmation d’une position réaliste et juste dans le débat en cours. Le philologue en profite pour construire dans ce texte un nouvel objet d’étude : l’histoire de l’orthographe française.
2.3. L’histoire au lendemain de la « bataille de l’orthographe » : Léon Clédat (1910)
14La phase de l’historiographie de l’orthographe qui s’ouvre à la fin des années 1860 s’achève au début du XXe siècle, au lendemain de la « bataille de l’orthographe » (Catach 1985)12. Dans cette polémique, le problème de la réforme, remise à l’ordre du jour en 1891 par la circulaire du ministre de l’Instruction publique Léon Bourgeois, qui prône la tolérance orthographique aux examens, rencontre la question pédagogique, devenue éminemment pressante depuis les lois Ferry des années 1880. Durant toute cette phase, qui se solde par l’abandon de toute tentative de réforme orthographique, les débats se tendent entre les linguistes, dont plusieurs décident de publier des textes en orthographe réformée, et les écrivains, majoritairement réfractaires, sous l’égide de l’Académie française. L’histoire de l’orthographe demeure l’un des principaux arguments auxquels se réfèrent les deux camps : les uns afin de montrer que des rapports graphophonologiques plus simples ont existé par le passé, les autres pour justifier le maintien d’une orthographe témoignant du passé de la langue grâce aux graphies « étymologiques ». Malgré tout, le débat se solde à peine par quelques tolérances orthographiques aux examens fixées par un arrêté ministériel en 1901.
15Pour autant, les discussions se poursuivent encore pendant quelques années. En 1905, au lendemain de l’échec de la troisième et dernière commission réunie par le ministère de l’Instruction publique en vue de réformer l’orthographe française, présidée par Brunot, Clédat publie des Notions d’histoire de l’orthographe. Ce professeur à l’Université de Lyon et ancien élève de Paris, auteur de plusieurs manuels de grammaire historique à destination des enseignants scolaires, n’écrit cependant pas un manuel d’histoire de l’orthographe proprement dit, contrairement à ce que pourrait laisser croire le titre. Il annonce dès le début que « pour discerner le bon et le mauvais dans le fatras orthographique actuel, il est indispensable d’avoir des notions d’histoire de la langue et de l’orthographe » (Clédat 1910 : 6). L’objectif affiché est donc de s’appuyer sur l’histoire de l’orthographe, en lien avec l’histoire de la langue – qui s’en distingue –, afin de donner aux maîtres des éléments pour discriminer, parmi les graphies non standard de leurs élèves, celles qu’il convient d’accepter de celles qui sont répréhensibles.
16La dimension historique du livre reste limitée. D’ailleurs, son plan ne fait apparaître aucune périodisation. Il s’organise par type de difficultés orthographiques rencontrées par les élèves : « consonnes finales », « consonnes muettes non finales », « voyelles muettes », « lettres grecques », « voyelles nasales », « voyelles orales », « consonnes », « apostrophe, tréma et accents ». À cela s’ajoute un appendice sur l’accord du participe passé. En l’absence de la notion de « graphème », c’est la lettre – et, secondairement, les signes diacritiques – qui sert d’unité pour penser les formes écrites, abordées dans une perspective phonographique.
17À la différence de Paris, Clédat n’a pas l’ambition de proposer un récit historique de l’évolution de l’orthographe. C’est pourquoi son point de vue est essentiellement rétrospectif : il s’agit d’éclairer l’origine des graphies contemporaines et non de suivre les évolutions graphiques du latin au français. Il n’accorde d’ailleurs aucune place au Moyen Âge et semble s’appuyer sur des sources qui sont à peu près semblables à celles de Firmin-Didot plus de 40 ans plus tôt, à l’exception du Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVIIe siècle jusqu’à nos jours ; précédé d’un Traité de la formation de la langue, paru entretemps (Hatzfeld, Darmesteter & Thomas 1888).
18En somme, dans cette première période, les travaux qui thématisent l’histoire de l’orthographe sont très peu nombreux et chacun d’eux s’inscrit dans une œuvre individuelle. Ils restent essentiellement motivés par la réforme orthographique et organisés autour de prises de positions vis-à-vis de l’Académie française, même si l’essai de Paris, resté sans lendemain, s’en démarque, à la fois par un questionnement historique et par la place qu’il accorde au Moyen Âge. Bien qu’hétérogènes, les finalités qui sous-tendent les différents projets d’écriture, à savoir promouvoir une réforme, rechercher la « vérité » orthographique et orienter les enseignants face aux erreurs des élèves, ne sont pas incompatibles entre eux. Très tôt, l’histoire de l’orthographe se présente à la fois comme un objet de connaissance, un instrument militant et un outil formatif. Pour autant, de façon générale, aucune méthode stable et fiable pour faire l’histoire de l’orthographe ne se dégage et si le domaine commence à être identifié en tant que tel, il n’est en aucun cas un domaine de spécialité.
3 | Le temps de la spécialisation (XXe siècle)
D’une thèse à l’autre : Charles Beaulieux (1927) et Nina Catach (1968)
19Deux noms restent aujourd’hui principalement associés à l’histoire de l’orthographe française : celui de Beaulieux, bibliothécaire en chef à l’Université de Paris, qui publie en 1927 sa thèse intitulée Histoire de l’orthographe française, et celui de Catach, chercheuse au CNRS dont la thèse de doctorat, L’orthographe française à l’époque de la Renaissance. Auteurs, imprimeurs, ateliers d’imprimerie, est publiée en 1968. À plusieurs dizaines d’années d’écart, ces deux travaux présentent de nombreux points de convergence.
20Le premier est le rôle qu’ils attribuent à Brunot et à l’Histoire de la langue française dans le choix de leur objet de recherche. Dans sa préface, Beaulieux le rappelle en ces termes.
Nous avions pris comme thème cette phrase de la Préface de l’Histoire de la langue française de notre maître Ferdinand Brunot : « Si on nous a dit comment Meigret et tous ceux qui comme lui voulaient une orthographe rationnelle alors possible ont été vaincus, au grand dommage de notre langue, nous ne voyons pas au juste par qui, nous ne pouvons suivre nulle part la formation de cette orthographe qui tend depuis lors de plus en plus à l’unité, dont seule une histoire critique et détaillée des œuvres sorties de chaque atelier d’imprimerie comparée à celle des autographes de l’époque pourrait nous faire connaître la constitution, les progrès et les reculs. » (Beaulieux 1927 : VII)
21Pour sa part, Catach s’exprime ainsi :
J’ai pris pour thème de recherches, en ce qui concerne la période qui m’intéressait et qui est celle de la Renaissance française, une réflexion de F. Brunot : « Resterait à examiner quels progrès l’orthographe a faits dans les impressions. C’est une étude qui devra être entreprise, mais qui ne pourra être complétée que quand l’histoire de l’imprimerie, telle qu’elle a été commencée pour le XVe siècle par la magnifique publication de M. Claudin, aura été poussée jusqu’au bout13. En effet, les écrivains ont été, de bon gré ou non, mis dans l’orthographe de leur imprimeur. On sait comment les recommandations que pouvait faire un Montaigne se heurtaient au parti-pris, ou à la négligence des compositeurs et des protes. Ce sont ces derniers qui ont fait l’usage. (Histoire de la Langue française, t. II, p. 120.) » (Catach 1968 : X)
22Dans les deux cas, il s’agit d’aborder un point aveugle des connaissances en histoire de la langue française situé à la Renaissance et pointé par Brunot. L’insistance sur cette période n’est pas anodine car elle est conçue, depuis Michelet, comme le brillant début de la « modernité » européenne, par opposition au sombre Moyen Âge (Le Goff 2014). Il s’agit donc de prouver que cette vision historique se vérifie aussi sur le plan orthographique, où s’opposent le progrès incarné par les savants humanistes et l’arrière-garde représentée par les travailleurs de l’imprimerie. En outre, bien que les deux citations retenues soient tirées de volumes différents de l’œuvre de Brunot, elles évoquent toutes deux l’importance du travail des imprimeurs et des imprimés en tant que sources pour l’histoire de l’orthographe. Sur le plan méthodologique, elles prônent, d’une part, la comparaison entre les imprimés et les manuscrits autographes et, d’autre part, leur mise en série sur un temps long. Ainsi, l’histoire de l’orthographe, si elle s’apparente à l’histoire de la langue française et la complète, doit opérer de manière spécifique, ce que tant Beaulieux que Catach cherchent à mettre en œuvre.
23Ces deux ouvrages entretiennent justement une parenté importante du point de vue des sources et de la méthode. Beaulieux détaille, dans sa préface, la manière dont il a mené son enquête : partant des imprimés du XVIe siècle disponibles dans les bibliothèques parisiennes, il a tenté de remonter le plus loin possible dans la constitution de l’orthographe française. Après avoir examiné les documents de la pratique produits par le Parlement et la Chancellerie royale au XIIIe siècle, il s’est finalement intéressé au haut Moyen Âge et aux rapports entre graphies et prononciation du latin en Gaule. Pour autant, Beaulieux ne vise pas à l’exhaustivité : « nous n’avons pas eu la prétention de faire une histoire complète de notre orthographe : une vie entière n’y eût pas suffi » (1927 : XVII).
24Catach cite justement cette phrase de Beaulieux dans sa propre préface, où elle rappelle ce qu’elle doit à son prédécesseur. Si elle travaille sur la Renaissance, c’est aussi parce que le travail de Beaulieux s’arrête en 1549 et qu’il n’a traité que des dictionnaires, sans prendre en compte l’ensemble des imprimés, corpus qu’il avait pourtant exploré. Ainsi, ce sont les notes manuscrites de Beaulieux pour un troisième tome, jamais publié, qui ont constitué le point de départ de sa propre recherche. Elle y a ensuite ajouté les dépouillements qu’elle a effectués dans la réserve de la Bibliothèque nationale. Ainsi, cette seconde thèse s’appuie explicitement sur la version publiée et sur les notes préparatoires de la première.
25Toutefois, le contexte savant des années 1960 est bien différent de celui du début du XXe siècle : les progrès de l’histoire du livre en général, dont celle de la typographie et la bibliographie historique, ainsi que le développement de nouveaux courants de recherche littéraires et linguistiques, sous l’influence du structuralisme, permettent et nécessitent un renouvellement de l’approche de l’histoire de l’orthographe. Celle-ci doit alors s’intéresser véritablement au travail des typographes plutôt qu’aux tentatives de réforme, centrales dans la période précédente. En revanche, et c’est là une différence majeure par rapport à Beaulieux, c’est bien en tant que « système » évolutif, ancré dans des pratiques d’écriture et de diffusion de l’écrit, que Catach entend aborder l’orthographe française.
Théories orthographiques et faits typographiques ne nous ont retenue que par leurs rapports mutuels, rapports assez importants à l’époque-charnière que constitue la Renaissance pour constituer à nos yeux la voie transitionnelle entre le système orthographique du moyen-français (système manuscrit) et le système orthographique du français moderne (système imprimé). (Catach 1968 : XII)
26Au-delà de la continuité revendiquée avec Beaulieux, Catach affirme aussi des désaccords théoriques majeurs14. Elle insiste tout spécialement sur un fait occulté par Beaulieux :
Notre lexique, notre grammaire, notre évolution phonétique elle-même, pour ne pas parler de notre poésie, de notre prose, du rythme de nos phrases, etc., sont imprégnés d’une même réalité : la formation savante de notre langue écrite, qui a elle-même fortement influencé notre langue parlée. (Catach 1968 : XIV)
27Il y a donc bien lieu de repenser les rapports entre oral et écrit pour sortir du phonocentrisme dominant, qui faisait de l’écrit un miroir toujours déformant de la langue parlée15, pour prendre en compte d’autres types de relations, parmi lesquelles l’effet Buben16. De fait, pour Catach, il est indispensable de penser l’orthographe en linguiste, mettant en relation les différents aspects qui rentrent en interaction : phonique, morphologique, étymologique, analogique, distinctif. Elle s’inspire de l’approche proposée par le linguiste russe Gak dans son livre paru en 1956 et traduit sous le titre L’orthographe du français. Essai de description théorique et pratique (1976) et qui, malgré une approche essentiellement structurale et synchronique de l’orthographe, consacre tout de même quelques pages à son histoire parmi les « principes directeurs de l’orthographe française ».
28En somme, ces deux thèses prouvent que l’histoire de l’orthographe est bien devenue, au XXe siècle, un objet d’étude en soi, doté d’une légitimité liée à sa complémentarité avec l’histoire de la langue, d’une part, et avec l’ensemble des spécialités liées à l’écrit et à l’écriture, d’autre part. En revanche, son lien avec la réforme orthographique a alors perdu de son actualité.
29Catach ne reprend pas à son compte l’ambition d’exhaustivité – restée inaccomplie – de Beaulieux, qui visait à compléter, sur le plan orthographique, l’Histoire de la langue française de Brunot. Toutefois, elle a une visée chronologique qui déborde la Renaissance et souhaite dépasser la description historique de l’orthographe française et la recherche d’explications à son fonctionnement. Elle veut en proposer une modélisation, ce qui implique une considérable entreprise documentaire : elle estime qu’il faudrait, dans un premier temps, réaliser des « études graphiques détaillées des usages de chaque imprimeur et atelier d’imprimerie, éditions critiques des auteurs et des grammairiens de cette époque » (Catach 1968 : X). Pour autant :
Quand bien même nous serions en possession de ces éléments, qui constitueraient en quelque sorte nos archives orthographiques, le travail de classement, d’analyse et de synthèse de ces archives ne pourrait se concevoir valablement que dans le cadre d’une étude collective et outillée en conséquence. (Ibid.)
30C’est dans cette étude collective qu’elle s’engage dès 1962 avec le groupe de recherche sur l’histoire et la structure de l’orthographe (HESO), qu’elle a fondé. La spécialisation croissante et la collaboration ainsi mises en place permettent d’articuler l’histoire de l’orthographe, non seulement à l’histoire de la langue, mais aussi à la description orthographique contemporaine en synchronie, au traitement informatique des données orthographiques et aux questionnements sur l’enseignement de l’orthographe. Tout ceci concourt à la réalisation d’un projet de grande ampleur qui aboutit à plusieurs réalisations majeures dans les années 1990.
3.2. Les années 1990 : l’ambition synthétique
31Il est impossible de revenir ici sur l’ensemble des travaux menés par le groupe de recherche HESO, qui dépassent largement l’objet du présent article. On soulignera simplement que ces travaux aboutissent d’abord, pour ce qui est de l’histoire de l’orthographe, à plusieurs thèses de doctorat analysant de manière approfondie des périodes restreintes, conformément au souhait exprimé par Catach (1968)17. Le travail effectué se conclut, ensuite, par la publication en 1994 d’un ouvrage collectif de très grande ampleur : le Dictionnaire historique de l’orthographe française (Catach, éd., 1994).
32Choisir le genre du dictionnaire et, par conséquent, le mot comme unité descriptive – plutôt que la période historique – interdit toute construction d’un récit historique unifié. Il autorise, en revanche, une approche systémique de l’orthographe, conçue comme la somme des régularités dégagées parmi l’ensemble des graphies analysées dans une perspective diachronique. L’ouvrage s’appuie donc sur des conceptions de l’histoire et de l’écriture qui sont explicitées ainsi :
Nous nous sommes efforcés, non de suivre linéairement chaque rapport lettre/son un à un, mais de comprendre les liens et l’interaction des faits, aux diverses époques qui se sont succédé. […] [N]otre vision de l’écriture est, en effet, non celle de « hasards accumulés » résistant à toute approche d’ensemble, mais, à chaque étape, pour l’essentiel, celle de véritables synchronies successives. (Ibid. : VIII‑IX)
33Les sources exploitées et le traitement qui en est fait ont donc toute leur importance pour parvenir à dégager ces règles. Le projet s’est appuyé sur des dictionnaires du XVIe au XXe siècle, exploités de deux manières. D’une part, une base de données informatisée, commencée dans les années 1960, contient l’ensemble des formes graphiques des mots présents dans le Dictionnaire de l’Académie, de la première (1694) à la huitième édition (1935). L’automatisation du traitement et le travail statistique qu’elle permet offrent la possibilité de dégager des règles graphiques fondées sur la fréquence des occurrences. D’autre part, une vingtaine de dictionnaires, dont ceux de Estienne (1549) et de Nicot (1606) sont systématiquement collationnés de manière à pouvoir étudier de façon très détaillée environ 2000 mots du « vieux fonds » du vocabulaire français. Cependant, ce travail remet en cause certaines préconceptions concernant la norme orthographique.
Le principal phénomène auquel nous nous sommes heurtés, largement sous-estimé jusqu’ici, est celui de la variation graphique. Nous avons constaté celle-ci partout, entre les dictionnaires et à l’intérieur d’un seul et même texte, d’une édition à l’autre, pour un même mot à une époque donnée, sans compter les erreurs de transmission à tous les niveaux qu’il nous a fallu assumer. (Catach, éd., 1994 : XII)
34Ainsi, tant le travail collectif que l’informatisation des données font de cet ouvrage une étape essentielle dans la constitution de l’histoire de l’orthographe en tant qu’objet de recherche : la possibilité d’exploiter un très grand corpus en diachronie longue permet d’envisager l’orthographe en tant que système autonome par rapport à l’oral, régulier malgré d’importantes variations. La période considérée s’avère en outre fondamentale pour montrer que la variation graphique est une caractéristique du français écrit qui est loin d’être réservée au Moyen Âge.
Certes, certains de ces renseignements [i. e. sur l’origine des formes graphiques actuelles des mots du français] peuvent déjà figurer dans tel ou tel ouvrage spécialisé (encore concernent-ils surtout l’ancien français), mais non, pour ces cinq derniers siècles, accompagnés du premier témoignage, de la justification originale, pris pour ainsi dire « en direct », dans le contexte et le texte même où la forme est apparue. (Ibid. : VIII)
35L’objectif de l’ouvrage est bien d’éclairer la constitution de l’orthographe du français actuel en apportant de véritables explications et non une simple juxtaposition de formes. Il s’appuie pour cela sur une démarche descriptive plutôt que prescriptive, faisant ainsi diminuer la charge polémique attachée à l’histoire de l’orthographe. Le livre se place bien dans la lignée de Gak qui, le premier, « ne se pose ni en censeur, ni en défenseur inconditionnel de l’orthographe » (Catach, « Préface » in Gak 1976 : 9). Dans cette perspective, expliquer l’état de l’orthographe française actuelle, résultat d’une histoire, est un moyen de mieux en comprendre le système pour évaluer de manière rationnelle ce qui serait à conserver ou à éliminer dans le cadre d’une réforme. Cette idée – qu’on peut rapprocher de celle que défendait Paris un siècle plus tôt, dans un contexte épistémologique très différent – semble s’être implantée de façon durable chez les spécialistes d’histoire de l’orthographe.
36L’ambition de synthèse et de systématisation est également présente, sous une forme bien différente, dans l’Histoire de l’orthographe française de Catach, publié de manière posthume en 200118. L’approche est cette fois-ci chronologique, des premières attestations du français écrit au VIIIe siècle jusqu’aux rectifications orthographiques (Conseil supérieur de la langue française 1990), que Catach a elle-même contribué à élaborer. Le retour au récit amène Catach à mettre en évidence les trois parties complémentaires à prendre en compte pour faire l’histoire de l’orthographe : « historique, textuelle et linguistique » (2001 : 17). La partie « historique » correspond à l’intérêt pour les aspects matériels de l’écriture – que pointait Brunot – ; la partie « textuelle » renvoie aux textes et à une approche plus philologique, prenant notamment en compte les variantes ; enfin, dans la partie « linguistique », où l’histoire de l’orthographe est à la fois un plan de description à côté de la phonétique, de la syntaxe ou encore de la sémantique et une modalité d’existence de la langue. Ce dernier point amène Catach à ajouter une note qui montre que l’histoire de l’orthographe est loin d’être détachée des débats sur l’écriture.
Prenant conscience que l’écriture n’est pas la langue (orale), mais en
fait une autre langue, tout aussi complète que la
première, en tant que moyen de communication, certains n’hésitent pas
aujourd’hui à demander pour la seconde une étude entièrement autonome,
entreprise que je juge pour ma part, si elle est poussée à l’extrême,
vouée à l’échec et d’ailleurs parfaitement inutile lorsque l’on peut
faire autrement19. (2001 : 18, note
6)
37L’approche de Catach dans les années 1990 se situe ainsi dans le prolongement de ses premiers travaux, qui reliaient histoire de la langue française et histoire de l’orthographe. Elle s’oppose ainsi à l’autonomie de la graphématique défendue par Anis, qui, pour sa part, la place dans le courant « phonographiste ».
Le modèle construit par N. Catach et l’équipe HESO-CNRS s’appuie sur les perspectives ouvertes par Gak, bien que l’affinement théorique et le travail empirique mené sur une vaste échelle lui donnent une cohérence et une solidité plus grandes. On y retrouve en effet le même dualisme asymétrique : là où le phonographisme échoue à rendre compte des données, on fait intervenir d’autres facteurs20. (1988 : 81)
38L’histoire de l’orthographe, comme toute description linguistique, ne peut donc faire l’économie d’une théorisation de la langue en général et des relations entre oral et écrit en particulier. Les synthèses élaborées dans les années 1990 autour de Catach s’inscrivent dans des débats scientifiques de leur temps, mais cherchent aussi à répondre, avec des outils spécialisés, aux questions vives de la société.
4 | L’histoire de l’orthographe, un enjeu social (années 2000-2020)
39La question orthographique reste d’actualité depuis les années 2000. Sur fond d’une large médiatisation du discours sur la baisse du niveau des élèves en orthographe, l’application des rectifications orthographiques de 1990 continue de faire débat, en particulier en 2016, alors que des éditeurs de manuels scolaires s’apprêtent à les mettre en œuvre. L’histoire de l’orthographe s’affiche alors dans les titres de plusieurs publications, mais qui ne sont pas, pour la plupart, exclusivement consacrées à cet objet. Nettement plus courts que ceux de la période précédente, ces livres s’inscrivent dans deux genres discursifs : la vulgarisation scientifique et les manuels universitaires.
4.1. L’histoire de l’orthographe pour dépassionner le débat sur la réforme ?
40Dans le corpus analysé, nous avons considéré que trois volumes relevaient de la vulgarisation scientifique21. Il s’agit de L’orthographe en crise à l’école : et si l’histoire montrait le chemin ? de Chervel (2008), Petite histoire de l’orthographe française de Wilmet (2015) et Une brève histoire de l’orthographe de Cheminée (2017). Leurs auteurs présentent des profils différents. Chervel, est l’auteur d’une thèse bien connue sur l’histoire de la grammaire scolaire (1977). Il a travaillé essentiellement à l’Institut national de recherche pédagogique (INRP) où il a élargi son champ d’expertise à l’histoire de l’enseignement du français et à l’histoire des disciplines scolaires en général. Wilmet – seul auteur belge du corpus – était initialement médiéviste, avec une thèse sur le système de l’indicatif en moyen français soutenue en 1968. Devenu professeur dans plusieurs universités belges, il a occupé de multiples fonctions institutionnelles liées à la langue française, en Belgique et en France. Cheminée, qui a soutenu en 1996 une thèse en sciences du langage dans le domaine de la sémantique, a publié de nombreux dictionnaires à destination des enfants.
41Le genre de la vulgarisation scientifique est assumé dès le titre des ouvrages de Wilmet et Cheminée, où l’adjectif « petite » ou « brève » précède le nom « histoire ». On le retrouve chez Chervel, qui écrit :
Ce petit livre s’adresse prioritairement à tous ceux qui sont chargés de l’enseignement de l’orthographe, mais également à ceux, et ils sont nombreux, qui s’intéressent à l’écriture du français. Il n’a d’autre objet que de présenter en quelques dizaines de pages l’état actuel de nos connaissances en matière d’histoire de l’orthographe, d’histoire de son enseignement et d’histoire de la maîtrise de l’orthographe par les Français. (2008 : 5)
42S’adressant à un public large, l’ouvrage ne présente pas des recherches originales mais un panorama des connaissances actuelles, ce que Cheminée affirme aussi sans détour : « Nous avons voulu dans cet ouvrage donner accès à des informations que le public, en général, ignore, car elles restent confinées dans des cercles érudits. » (2017 : 87) L’enjeu est donc moins de faire progresser que de diffuser les connaissances en histoire de l’orthographe. Quant au livre de M. Wilmet, il s’agit de la publication d’une conférence prononcée en 2014 à l’Académie royale de Belgique, qui offre au grand public des cours-conférences gratuits, sur un modèle proche du Collège de France. Le texte a pour objectif d’« identifier la source des difficultés graphiques du français [et] montrer à quel point les hantises orthographiques propres à notre culture ont entrainé la dénaturation de l’enseignement grammatical » (Wilmet 2015 : 3). L’auteur fait donc le choix d’assumer un parti-pris polémique et d’utiliser l’histoire de l’orthographe comme argument pour réformer plutôt les représentations de l’orthographe et son enseignement que l’orthographe elle-même. Cette distinction recoupe en partie celle que fait Chervel dans la citation précédente, entre une histoire de l’orthographe proprement dite, qu’on pourrait qualifier « d’interne » et qui porterait sur l’évolution des graphies, et deux histoires « externes », concernant la transmission institutionnelle de la norme orthographique ainsi que le rapport entre celle-ci et les pratiques réelles. Dans les trois ouvrages, on constate une forte conscience du rôle social de l’orthographe et de l’intensité de la relation à l’orthographe des francophones, promue par les systèmes éducatifs français et belge, ainsi que par l’Académie française.
43Ceci dit, l’objectif d’information plutôt que de formation auquel répondent ces ouvrages offre aux trois auteurs une relative liberté dans la manière de présenter l’histoire de l’orthographe, ce que traduit la diversité des périodisations proposées. Chervel, parce qu’il examine cet objet au prisme de l’enseignement, d’une part, et qu’il s’appuie sur des archives et des enquêtes de terrain, d’autre part, ne fait débuter son étude qu’au XVIIe siècle, au moment où l’enseignement de la lecture en français commence à devenir un sujet de préoccupation. Il s’arrête au début du XXIe siècle, avec des questionnements très contemporains sur l’évolution de la maîtrise de l’orthographe par les Français. Le choix de Wilmet est bien différent puisqu’il commence au « temps des jongleurs », soit aux XIe-XIIe siècles, pour terminer par « la croisade de 1990 », titre révélateur de sa position réformatrice. Enfin, Cheminée remonte jusqu’à l’époque gallo-romaine avant d’en venir aux Serments de Strasbourg et de présenter, lettre par lettre, l’histoire de l’alphabet français et des rapports phonographiques. Elle déroule ensuite une histoire de l’orthographe jusqu’au XXe siècle en insistant sur le rôle du Dictionnaire de l’Académie, mais sans aborder les rectifications orthographiques de 1990.
44Le point commun de ces livres réside dans le fait de chercher à éclairer la situation contemporaine. L’intention est donc essentiellement argumentative, plus que descriptive. Pour autant, les points de vue défendus diffèrent. Wilmet conclut ainsi : « Dans les pays de culture française, une vraie réforme de l’orthographe passe d’abord par la réforme des mentalités » (Wilmet 2015 : 43). Cheminée considère que la connaissance historique doit inviter à la nuance et éviter toute position tranchée :
Quelle que soit la position qu’on se sente enclin à adopter, il importe de savoir que si notre orthographe est si difficile, les raisons en sont historiques. Il est donc inutile d’être passionnel à ce sujet. On peut être partisan du statu quo ou du changement en partant du même constat. Mais on ne peut faire l’économie de l’histoire. (2017 : 89)
45Pour Chervel, ce que montre l’histoire de l’orthographe, c’est que le choix n’est pas entre le statu quo et la réforme, mais bien entre une réforme radicale et une réforme modérée, l’important étant que l’orthographe puisse être transmise et, pour cela, qu’elle conserve le statut de discipline scolaire.
4.2. L’histoire de l’orthographe pour enseigner et pour former
46Deux ouvrages du corpus nous ont semblé appartenir au genre du manuel universitaire : Introduction à l’histoire de l’orthographe de Cazal & Parussa (2022 [2015]) et L’orthographe française : histoire, description, enseignement de Pellat (2023). Leurs auteurs ont des profils un peu plus proches que les précédents. Pellat, auteur d’une thèse portant sur un point de la langue française du XVIIe siècle en 1977, a lui-même participé au groupe de recherche HESO22. Cazal & Parussa, ont toutes les deux soutenu des thèses au milieu des années 1990 dans le domaine de la philologie médiévale et travaillent en linguistique diachronique.
47Les deux ouvrages s’adressent explicitement à des publics d’étudiants et d’enseignants en formation. Cazal et Parussa entendent leur donner accès à « des savoirs universitaires jusque-là dispersés dans des revues spécialisées et peu accessibles » (2022 [2015] : 5). De même, Pellat affirme : « Ce livre constitue la synthèse de nos recherches personnelles et de nos lectures de très nombreux ouvrages, dont une partie figure en bibliographie classée » (2023 : 13). L’histoire de l’orthographe reste un domaine qui nécessite la médiation de spécialistes, d’abord en raison de difficultés matérielles d’accès aux connaissances. Or ces publications interviennent dans un contexte universitaire nouveau, lié à la transformation des concours de recrutement des enseignants du primaire et du secondaire. Cazal et Parussa le formulent de la façon suivante.
Les épreuves de grammaire des concours de recrutement (Professorat des écoles, CAPES, Agrégation) replacent la question de l’orthographe dans la formation des maîtres en restaurant son lien avec l’histoire et la linguistique de l’écrit. À l’agrégation de lettres une « question de graphie » invite désormais les candidats à mettre en relation graphie et phonie dans une perspective diachronique. La question est nouvelle, elle s’appuie sur des savoirs spécifiques qui sont exposés dans le présent ouvrage et sur une démarche propre à laquelle la plupart des exercices proposés serviront d’entraînement. (Cazal & Parussa 2022 [2015] : 5)
48L’histoire de l’orthographe répond donc, dans ce cadre, à un besoin très concret qui nécessite de créer, pour la première fois, des exercices associés à ce savoir qui tend à devenir, au-delà d’un objet de recherche, une discipline universitaire. Celle-ci reste sans pendant scolaire, mais apparaît comme un savoir instrumental à l’endroit de l’enseignement de l’orthographe. On retrouve ici la préoccupation de Clédat en 1910, à ceci près qu’il n’est plus question de tolérance vis-à-vis des erreurs des élèves mais, à l’inverse, d’une manière d’outiller les enseignants pour mieux expliquer les règles.
49Dans les deux manuels envisagés, les bornes chronologiques considérées sont similaires, « à partir des plus anciens textes écrits (9e siècle) jusqu’à la formulation des règles orthographiques actuelles », comme l’écrivent Cazal & Parussa (Ibid.). Ces bornes correspondent à celles de Catach (2001). Le découpage interne diffère, en revanche. Pellat propose une périodisation en deux phases, qu’il décrit ainsi :
L’histoire de l’orthographe peut se découper en deux périodes successives. Dans le premier chapitre, on parcourt l’évolution des usages graphiques et les hésitations sur la norme orthographique des origines au XVIIIe siècle. […] Et, dès le XVIIe siècle, à la suite de la création de l’Académie française (1634), se met progressivement en place l’orthographe d’Etat, qui s’impose au XIXe siècle après le dictionnaire de 1835 et qui est diffusée par l’enseignement, surtout sous la Troisième République. Des propositions de réforme émergent régulièrement ; la dernière officielle en date, les Rectifications de l’orthographe (1990), ouvre des perspectives d’évolution de la norme orthographique sur des points précis. (2023 : 16)
50C’est donc la création de l’Académie française et la standardisation qu’elle instaure peu à peu qui constituent, selon lui, le pivot d’une phase à l’autre. Cazal & Parussa, quant à elles, proposent plutôt un découpage par périodes d’un à deux siècles, correspondant plus ou moins à celui qu’on fait traditionnellement de l’histoire de la langue française, familier des étudiants (Tableau 3).
Tableau 3 : Plan de la partie « La constitution du système graphique du
français » (Cazal & Parussa 2022 [2015])
|
51Cependant, les autrices insistent sur la double approche « interne » et « externe » de l’histoire de l’orthographe française : elle est à la fois considérée comme un objet de débat et comme une pratique avant de devenir, dans l’histoire la plus récente seulement, une prescription.
On y trouvera une description des lieux où l’on écrit la langue française, des acteurs concernés par la pratique de l’écriture manuscrite et par l’imprimerie, et des modalités de diffusion des textes écrits. Pour chaque période, sont mises en évidence les caractéristiques principales de l’écriture du français, ainsi que les aspects fondamentaux du débat orthographique depuis le 14e siècle jusqu’à 1990. (Cazal & Parussa 2022 [2015] : 6)
52Ces deux manuels témoignent ainsi d’un questionnement sur la nature de la norme orthographique et des moyens par lesquels elle s’est imposée. Néanmoins, le sous-titre « Histoire, Description, Enseignement » du livre de Pellat le situe dans la lignée des travaux de l’équipe HESO, avec une relation forte entre ces différents points de vue sur l’orthographe, la connaissance historique se présentant comme un préalable aux autres angles d’étude. Chez Cazal & Parussa, les références à Catach sont plus ponctuelles et circonscrites. Elles s’en tiennent au point de vue historique, mais le font en accordant une place importante à la variation graphique. Malgré des projets éditoriaux qui, dans une certaine mesure, se rejoignent, les deux ouvrages ne relèvent pas de la même perspective scientifique.
5 | Conclusion
53Depuis un siècle et demi, l’histoire a été mobilisée dans tous les débats sur l’orthographe. Que le contexte épistémologique soit celui de la grammaire historique, de la linguistique structurale ou, plus récemment, d’une approche variationniste de la langue, trois grands axes structurent les manières d’envisager l’histoire de l’orthographe.
54Le premier est lié aux acceptions de la notion d’histoire de l’orthographe, qui peut recouvrir des objets très divers, dont les délimitations restent parfois imprécises : les pratiques orthographiques (celles des écrivains, des imprimeurs ou encore des élèves), la norme et sa fixation, les tentatives de réforme, l’enseignement ou bien les représentations et les discours sur l’orthographe. Dans toutes ces perspectives, interviennent en proportion variable des problèmes de description « interne », c’est-à-dire des rapports graphophonologiques, et d’histoire « externe », liés à la très forte institutionnalisation de l’orthographe française, par le biais de l’Académie française dès le XVIIe siècle, mais aussi par celui de l’école à partir du XIXe siècle.
55Le deuxième axe est celui de la périodisation de l’histoire de l’orthographe française car les bornes chronologiques qui lui sont assignées changent aisément, au gré des sources et des outils de traitement des données disponibles, d’une part, et de l’objectif assigné à l’ouvrage, d’autre part. Si le XVIe siècle, avec la naissance de l’imprimerie et les multiples propositions de réforme orthographique, ainsi que le XVIIe siècle, marqué par la naissance de l’Académie française, y occupent depuis le début une place prépondérante, le Moyen Âge est intégré en fonction des spécialités de celles et ceux qui traitent le sujet. De même, les différentes éditions du Dictionnaire de l’Académie, jusqu’aux plus récentes, sont toujours présentées, tandis que les rectifications orthographiques de 1990 sont parfois passées sous silence dans les ouvrages récents.
56Enfin, le troisième axe est celui de la relation de l’orthographe à son histoire. L’importance relative accordée à la norme et à la variation est, dans ce cadre, un critère essentiel pour différencier les approches. L’histoire de l’orthographe a servi d’abord à rechercher des modèles – que ce soit celui d’une orthographe idéale perdue ou ceux de propositions de réforme –, puis à élaborer des outils de compréhension de l’orthographe contemporaine dans une perspective systémique avec, selon les cas, une visée descriptive ou plus directement pratique, par exemple pour enseigner l’orthographe. Dotés d’une forte dimension argumentative, les discours sur l’histoire de l’orthographe révèlent, parfois avant tout, des positions sur l’orthographe française de leur temps.
- 1 La liste complète des travaux inclus dans ce corpus et la méthode de constitution sont détaillées en annexe. Je remercie Timéo Pellegrin pour son aide dans la première analyse du corpus.
- 2 L’italique est de. Firmin-Didot.
- 3 L’appendice n’a pas été dotée par l’auteur d’un titre général. Nous proposons celui-ci.
- 4 Il publie également, entre les deux éditions, un Résumé des observations sur l’orthographe présentées à l’Académie française (1867b) ainsi qu’un Essai sur l’orthographe des mots composés (1867c), qui est un extrait des Observations (1867a).
- 5 Elle a été fondée en 1864.
- 6 La leçon d’ouverture de ce cours est publiée dès l’année suivante sous le titre Grammaire historique de la langue française (Paris 1868).
- 7 Le terme philologie renvoie alors tant à l’établissement des textes anciens et leur édition, qu’à l’étude littéraire de ces textes et à la description de la langue dans laquelle ils sont écrits et, plus largement, à celle des langues en général. Sur la manière d’envisager la philologie en France à cette époque, voir Bähler (2004).
- 8 Cette deuxième partie contient également, sans que cela soit mentionné initialement, une évaluation de l’édition par l’archiviste de l’Académie française, Marty-Laveaux, du travail de l’historien de Mézeray, paru en 1673 sous le titre Cahiers de remarques sur l’orthographe françoise : pour estre examinez par chacun des Messieurs de l’Academie, avec des observations de Bossuet, Pellisson, etc. (Marty-Laveaux, éd., 1863).
- 9 Les italiques et la majuscule sont de Paris.
- 10 Il n’en deviendra membre qu’en 1896.
- 11 Les italiques sont de Paris.
- 12 L’article cité ici est une synthèse. Une étude plus détaillée a été publiée par Catach en cinq livraisons du Français moderne entre 1963 et 1971.
- 13 Catach fait ici référence à l’ouvrage de Claudin (Histoire de l’imprimerie en France au XVe et au XVIe siècle, 1900-1914, Paris, Imprimerie nationale, 4 vol.).
- 14 Elle les emprunte partiellement à l’archiviste et historien Fournier (1940), qui pointe en particulier : l’admiration de Beaulieux pour l’orthographe du XIIe siècle, dont il attribue la responsabilité aux écoles de jongleurs, qui ne sont pourtant pas attestées avant le XIVe siècle ; la surévaluation du rôle des interventions conscientes sur les faits de graphie ; l’idée selon laquelle les scribes auraient multiplié les lettres dites « quiescentes » entre la fin du XIIIe et le XVIe siècle pour augmenter leurs revenus ; l’absence de prise en compte de l’emploi des abréviations et de leurs effets sur l’orthographe française ; le manque de données sur l’usage des lettres étymologiques chez l’ensemble des scripteurs médiévaux, au-delà des praticiens du droit et de l’administration.
- 15 Sur ce point, voir Testenoire (2016).
- 16 On désigne ainsi le fait que l’orthographe influence la prononciation, phénomène étudié par Buben dans son livre Influence de l’orthographe sur la prononciation du français moderne (1935).
- 17 On pense par exemple à celles de Baddeley sur Les Rapports entre Réforme religieuse et réformes orthographiques au XVIe siècle en France (1991), et de Biedermann-Pasques, Les grands courants orthographiques au XVIIe siècle et la formation de l’orthographe moderne : impacts matériels, interférences phoniques, théories et pratiques (1990).
- 18 Catach est décédée en octobre 1997.
- 19 L’italique est de Catach.
- 20 L’italique est d’Anis.
- 21 On comprendra ici ce terme au sens de Jacobi, Schiele & Cyr : « un ensemble de pratiques sociales, empruntant des médias différents (textes, livres, audiovisuels, informatique, expositions…) pour contribuer à l’appropriation de la culture et [de la] technique par des non spécialistes en dehors de l’école » (1990 : 84).
- 22 Catach était membre du jury de son Habilitation à diriger des recherches (HDR) en 1994.