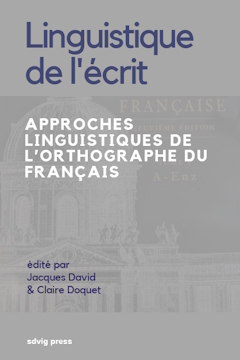Dédicace
1Nous dédions le présent volume de la revue Linguistique de l’écrit, à André Chervel qui est décédé le 3 mars 2025. Comme historien de la langue française et de son enseignement, nous lui devons un ensemble rationnel de travaux et de publications qui ont profondément éclairé la théorie grammaticale et son impact sur l’apprentissage de l’orthographe. Son regard critique va nous manquer, car comme il l’exprimait dans son premier ouvrage : « Avant la grammaire scolaire, on pouvait encore se permettre de contester, voire de réformer notre orthographe, au nom de l’usage, de la raison ou de la fantaisie. Depuis, il n’en est plus question : orthographe, grammaire, français "correct" forment un tout indis|solublement lié, unanimement considéré comme la base de toute la culture français. Le chauvinisme s’en mêle. Aussi est-il vain d’opposer aux partisans du statut quo que notre orthographe actuelle est de date récente, et qu’après maintes reprises on n’avait pas hésité à la modifier. L’ensemble culturel répressif où elle s’insère fonctionne trop bien : pas question de la remanier. » (Histoire de la grammaire scolaire… et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français 1977, p. 281-282).
2Après des siècles de débats, de rectifications souvent écartées, de réticences à toute réforme en profondeur (Catach 1985 ; Arrivé 1993), on pourrait penser que tout est dit du conservatisme, voire de la crispation, des Français sur leur orthographe1. De fait, si l’on porte un regard rétrospectif, la question orthographique se pose à tous les usagers du français ; elle a déjà fait l’objet de plusieurs projets de réforme, et ce depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles si l’on se réfère aux ouvrages de Meigret (1545) et de Brunot (1905)2. Ces projets ont à chaque fois été suivis de critiques évoluant vers des idéologies déconnectées de tout argument linguistique. Ils ont également entrainé des débats passionnés qui ont parfois suscité des « délires » (Catach 1989), et dont l’« impropriété » a encore été récemment démontrée (Sprenger-Charolles 2023).
3Le présent volume de Linguistique de l’écrit revient sur la question de l’orthographe française afin de dresser un état des lieux des connaissances aujourd’hui accessibles en sciences du langage par l’exploration de vastes corpus parfois issus de pratiques profondément modifiées par l’usage des nouvelles technologies. Il s’agit d’offrir aux lecteurs – et plus largement aux usagers de l’écrit – des éléments sur des recherches qui objectivent les acquis linguistiques dans le domaine. Notre ambition est de présenter un ensemble de travaux permettant de décrire et d’analyser le fonctionnement de notre orthographe et d'en dépasser les visions dogmatiques. Les travaux qui suivent identifient au moins deux dogmes : l’un qui évite de corriger les nombreuses graphies linguistiquement aberrantes de notre orthographe, supposée parfaite et conforme au « génie » de la langue ; le second qui repose sur une conception, voire une doxa pas toujours clairement exprimée, qui privilégie un unique point de vue, celui du lecteur.
4Le premier dogme consiste en la défense d’incohérences et d’erreurs orthographiques persistantes, au nom de l’étymologie et de la nécessité de garder trace des « racines » de la langue. Prenons deux exemples, celui des mots-composés qui devraient être soudés et du circonflexe et du tréma dont la fonction diacritique est désuète et parfois aberrante. Pourquoi accepte-t-on de souder des mots qui ne représentent plus aujourd’hui qu’un seul signifié, comme portefeuille ou bonhomme, alors que d’autres ayant les mêmes propriétés lexicales resteraient scindés, comme plate-forme ou coffre-fort ? De fait, l’argument du maintien du trait d’union avec les mots composés de deux noms ou avec un adjectif ne tient plus ; il se maintient arbitrairement et sans fondement linguistique. Pire, il maintient le doute sur la soudure de certains mots comme extraterrestre ou passeport. Si nous prenons le cas du tréma, nous constatons qu’il est appliqué au ‘e’ ou au ‘i’ dans aiguë et ambiguïté, mais de façon irrationnelle, puisque la voyelle qui supporte ce rôle diacritique est en fait le ‘u’. On le voit, la doctrine conservatrice reste difficilement compréhensible, car il s’agit de maintenir des formes dont la raison d’être repose sur une idéologie identitaire, autrement illustrée par le « génie de la langue française », véritable mythe linguistique dont Meschonnic a montré l’inanité théorique dans « sa clarté obscure » (1997).
5Concernant le second dogme, ses défenseurs les plus conformistes pensent qu’une réforme est inconcevable parce qu’elle perturberait le travail du lecteur, surtout si celui-ci est formé à une esthétisation quasi ésotérique des textes. Dans cette vision, toute tentative de simplification ou de régularisation se heurte à une rhétorique de l’hétérographie censée offrir un accès direct au sens des textes, en écartant tout risque d’ambigüité homophonique. Cette rhétorique se déploie selon des arguments souvent simplistes qui encombrent la transparence phonographique en accumulant des graphies étymologiques – ou faussement étymologiques comme le ‘ph’ de nénuphar3. Elle ne voit pas que, par voie de conséquence, elle privilégie la seule réception écrite, avec pour objectif de faciliter le travail du lecteur, notamment par la désambigüisation hétérographique des formes homophoniques. La même idéologie ne voit pas que cette focalisation en entraine une autre, sur le versant de la production écrite qu’elle alourdit conséquemment, jusqu’à plomber durablement toute pratique rédactionnelle, de la mise mots à la mise en texte. De fait, cette focalisation sur la réception des textes se développe au détriment de l’aisance à en produire. Toute l’histoire de notre orthographe peut ainsi se comprendre dans ce constat : ce que l’on gagne en lecture, on le perd en écriture. La logique de l’évolution du français écrit est ainsi tendue vers un moindre effort dans l’interprétation des textes (Eco [1979] 1985), et donc plus de contraintes en écriture ; des contraintes qui augmentent le temps et le cout des apprentissages scripturaux, et au-delà rédactionnels4. Il s’ensuit que personne ne peut être absolument assuré de « son » orthographe, même les plus lettrés. Nul n’est effectivement à l’abri de la « faute » – que l’on devrait plutôt percevoir comme une erreur, un oubli, un lapsus ou un doute –, surtout s’il doit rédiger un texte complexe, relativement long, mobilisant des connaissances abstraites, et plus encore dans un environnement bruyant, sous une fatigue attentionnelle et/ou une vigilance relâchée, notamment dans le cas d’écrits non publiés, comme les mails et les SMS.
6Plusieurs articles du présent numéro de Linguistique de l’écrit développent cette approche historique et critique, qui se comprend dans une épistémologie essentielle pour saisir des recherches plus contemporaines. Il en est ainsi de la comparaison des systèmes d’écriture et/ou des orthographes, et de leur nécessaire distinction. Nous verrons alors que les écritures, en tant que systèmes, possèdent des propriétés spécifiques qui reposent sur deux principes généraux, l’un essentiellement phonographique (ou alphabétique) et l’autre plus sémiographique (ou non-alphabétique), même si leur distribution orthographique les associe de façon rarement équilibrée. À ce niveau, les orthographes sont inscrites dans une histoire culturelle, sociale, politique toujours singulière, où se confrontent des décisions institutionnelles et des usages scripturaux inévitablement variés, hétérogènes voire contradictoires (Cerquiglini 1996). Cette distinction des systèmes d’écriture vs des orthographes permet d’analyser autrement l’hypothèse d’une autonomie de l’écriture du français et de sa dépendance à la langue orale, et plus encore à ses variantes parlées. Ces réflexions ont pu dès lors engager des travaux linguistiques qui analysent (ou réanalysent) la valeur, la consistance et l’étendue des unités orthographiques, en valorisant le statut du graphème dans une conception graphématique affranchie de l’oralité (Anis 1988 ; Harris 1993). Ces travaux s’étendant à d’autres théorisations – notamment liées au statut du signe linguistique – permettent de comprendre des formalisations, comme celle de Hjelmslev (1968), qui distingue les plérèmes conçus comme des unités de contenu à valeur sémiographique et les cénèmes qui correspondent à des unités linguistiques non signifiantes, généralement de seconde articulation5.
7Dans la même perspective, le plurisystème décrit et formalisé par Catach ([1989] 1995) a permis de saisir l’orthographe du français – et sa genèse – dans ses dimensions théoriques et ses applications. Les composantes de ce plurisystème se distinguent en différents plans d’élaboration et d’analyse de l’écriture, qui appartient aux principes généraux communs aux écritures et à ceux spécifiques de l’orthographe du français. Ainsi, s’appuyant sur les travaux princeps de Gelb ([1952] 1973) et de Gak (1976), Catach présente une structure orthographique du français qui permet aujourd’hui de l’appréhender dans une quadripartition spécifique comprenant deux composantes principales : la phonographie et la morphographie, et deux autres plus restreintes : l’idéographie et la logographie ; même si ces deux dernières sont depuis discutées en extension comme en compréhension (Jaffré 1997 ; Gak 2001).
8Au-delà des descriptions et modélisations linguistiques disponibles, les approches sociolinguistiques – et fondamentalement variationnistes – nous apparaissent également décisives, notamment pour envisager une linguistique de l’écrit appréhendé à la fois dans ses formes et ses usages spécifiques. Les articles que nous introduisons ici s’appuient sur des recherches qui décrivent les multiples usages scripturaux, qu’ils soient publics ou privés, dans des pratiques où le respect des règles orthographiques s’amoindrit, comme Lucci et Millet l’ont déjà montré dans leur ouvrage collectif de 1994. Ces recherches, et d’autres plus récentes, constatent que, depuis plus de 40 ans, l’orthographe a perdu l’importance et la rigidité qu’elle possédait depuis le milieu du XIXe siècle, à travers une série de travaux publiés par Blanche-Benveniste et Chervel (1969) jusqu’à Etève, Nghiem et Philbert (2022), que ce soit dans l’univers scolaire (Manesse et Cogis et al. 2007) ou universitaire (David et Rinck 2022), et au-delà dans les différents secteurs professionnels (Martin Lacroux 2015).
9Pour préciser ce paradigme, il conviendrait également d’étendre l’étude des écarts orthographiques constatés par C. Martinez et B. Ranty dans les Cahiers de doléances du Grand débat organisé par le président Macron en 2019 (cf. le site Orthodidacte 2019). Ce corpus considérable d’écrits sociologiquement diversifié et donc plus représentatif pourrait être mis en relation avec d’autres recherches, anciennes ou récentes, sur des corpus d’égale d’ampleur (Dabène 1987 ; Mout 2013), afin de montrer que les erreurs orthographiques affectent toutes les composantes de l’orthographe, mais dans des proportions variables et parfois inattendues. Ainsi, dans ces Cahiers de doléances du Grand débat, ce qui domine ce sont les absences ou les confusions d’accents (78 % des erreurs), qu’ils soient diacritiques (etat, education, trés) ou étymologiques (impot). Les mêmes écrits montrent aussi des erreurs morphosyntaxiques – mais proportionnellement moins nombreuses – qui sont classiquement associées aux accords adjectivaux (73 % des erreurs d’accord en genre et nombre : de manière direct ; les bénéfices important) et, dans une moindre proportion, aux formes verbales (il les poussent), notamment sur l’homophonie-hétérographie de leurs finales en /E/ (il faut discuté ; j’aurai aimer). Cette étude offre un champ de recherche précieux dont l’exploration pourrait permettre d’écarter les ornières idéologiques déjà évoquées et les conceptions doxiques en rapport. Dans ce mouvement, plusieurs des contributions du numéro montrent que l’analyse étayée et argumentée de corpus mériterait d’être développée, car ces corpus sont désormais plus nombreux et diversifiés, même s’ils ne sont pas toujours exploités. Ainsi, les corpus d’écrits publiés via internet (mails, blogs, forums, écritures créatives et autres fanfictions), et ceux disponibles sur des sites scientifiques institutionnels (notamment Ortolang) s’ouvrent à des données numériquement et qualitativement représentatives du français écrit produit, qu’elles soient produites par des scripteurs peu-lettrés ou en apprentissage ou par des rédacteurs expérimentés. De même, il apparait nécessaire de montrer comment certains usages individuels ou collectifs engendrent de nouvelles formes scripturales, plus ou moins normées ou autrement construites. Nous pensons ici aux néographies liées aux pratiques plurigraphiques, qu’elles soient privées, entre autres dans les écrits numériques déjà évoqués, ou publiques à l’image des créations artistiques appartenant notamment aux genres littéraires et poétiques. Ces recherches mettent au jour les limites et les incohérences de règles – ou de normes – culturellement inscrites dans l’orthographe de notre écriture.
10Dans cette perspective d’extension aux autres sciences du langage, qu’elles soient socio- ou psycholinguistiques, nous pourrons dès lors mieux comprendre ces problèmes orthographiques non comme des problèmes d’acquisition ou des manques d’enseignement, mais comme la non maitrise d’un système écrit lui-même imparfait, qui présente de nombreuses zones de dérégulation et d’incertitude (Benzitoun 2021).
11Les questions soulevées dans cette présentation se trouvent reprises, étendues et explicitées dans les articles qui suivent. Nous les avons organisés en deux ensembles : le premier qui concerne plus particulièrement l’approche des phénomènes historiques et linguistiques et le second qui envisage l’orthographe du français dans une perspective critique tout en présentant des propositions argumentées.
12Pour ouvrir le premier chapitre, Jean-Pierre Jaffré et Jean-Christophe Pellat explorent l’une des questions fortes de ce volume, également introduite dans cette présentation, en montrant que les premières écritures relèvent d’une genèse qui distingue puis associe deux principes fondamentaux : la phonographie et la sémiographie, dans des rapports qui oscillent entre contradiction et nécessité. Pour illustrer l’analyse linguistique et historique de ce « double processus », les auteurs présentent deux études : l’une qui porte sur la constitution du français, l’autre sur celle du japonais, chacune étant inscrites dans des milieux socioculturels et linguistiques contrastés. L’analyse conjointe de l’évolution des deux systèmes graphiques, parce qu’ils « conjugue[nt] les hasards de l’histoire et du temps et les nécessités de la communication écrite », décrit bien ce qui caractérise toutes les orthographes.
13Jean-Marie Klinkenberg et Stéphane Polis inscrivent leur réflexion dans un cadre large de sémiotique des écritures qu’ils nomment scripturologie. Ils proposent d’ajouter à la description habituelle de l’orthographe un volet pragmatique qui permette d’examiner, outre les systèmes d’écriture, les usages de l’écrit. Les auteurs distinguent trois niveaux de signification de l’écriture : le niveau graphémique, qui englobe ici, au-delà de l’acception la plus courante, tout ce qui relève du linguistique ; le niveau grammémique, lié au caractère visuo-spatial de l’écriture ; le niveau scriptémique, déterminé par le contexte d’actualisation de l’écrit dans son environnement. Ils se concentrent ici sur le niveau graphémique et articulent la notion de norme, dont ils décrivent les fonctionnements et la pluralité, et la notion d’agence qui renvoie aux effets produits par les usages scripturaux. La relation des agences et des normes est appréhendée de deux manières : les agences « adnormatives », où l’on examine ce que deviennent les normes à travers divers usages, et les agences « dénormatives », où sont examinées les conséquences des normes sur la matérialité des productions écrites.
14Muriel Jorge appréhende l’histoire de l’orthographe à travers l’étude de onze ouvrages consacrés à la question et publiés entre 1867 et 2023. L’objectif est d’analyser diachroniquement les facteurs de continuité et de rupture apparaissant entre ces travaux, pour dresser un tableau des enjeux à la fois sociaux et conceptuels qui sous-tendent cette évolution. Les différents ouvrages considérés sont évoqués dans l’ordre de leur parution et l’autrice met en perspective certaines de leurs caractéristiques pour examiner ensuite deux rôles possibles, à la fois très importants et très actuels, de l’histoire de l’orthographe : dépassionner les débats, notamment sur les possibilités de réforme, et constituer une aide pour l’enseignement de l’orthographe et la formation des enseignants.
15Pour clore cette partie relative à l’histoire de l’orthographe, Beatrice Dal Bo nous convie à analyser les écarts de segmentation non-normée des mots graphiques en s’appuyant sur quatre séries de lettres de scripteurs peu lettrés, échangées durant la Première Guerre mondiale. Elle nous fournit ainsi une typologie de phénomènes d’hypersegmentation ou d’hyposegmentation en tenant compte de la classe grammaticale des termes concernés. L’étude offre ainsi une analyse quantitative et qualitative des occurrences relevées ; elle montre comment ces scripteurs éloignés de leur proches perçoivent et produisent les formes de segmentation orthographique auxquelles ils sont confrontés. L’autrice parvient ainsi à distinguer celles qui apparaissent communes de celles qui correspondent à des pratiques personnelles.
16En ouverture du second ensemble, Christophe Benzitoun s’intéresse à l’évolution de l’orthographe du français dans sa relation avec les pratiques technologiques de l’écriture. Il constate ainsi que l’essor exponentiel des productions numériques modifie les usages scripturaux, tout en agissant sur le système orthographique et son acquisition, en dépit des discours défaitistes portés sur les enseignements conduits. L’étude invite également à une réflexion critique de l’usage des logiciels de correction, qui ne résolvent qu’en apparence les difficultés orthographiques des élèves-rédacteurs, et les écartent souvent d’une maitrise orthographique accomplie comme d’une compétence scripturale étendue.
17Puis Florence Epars et Roxane Gagnon examinent le contexte et les effets de deux innovations introduites en Suisse romande : l’intégration dans les manuels scolaires des rectifications orthographiques et l’effort pour employer à l’école un « langage épicène ». Les autrices décrivent le désarroi des enseignants, confrontés simultanément à la demande institutionnelle de respecter et d’enseigner des normes qu’ils perçoivent comme complexes et parfois difficilement conciliables. Elles exposent les raisons de ces difficultés, liées notamment à la diversité terminologique, et dessinent des pistes de formation des enseignants basées sur l’articulation entre une norme unique (l’orthographe rénovée) et la coexistence de plusieurs normes (l’écriture inclusive), articulation nécessaire mais non évidente qui constitue un levier pour l’observation du fonctionnement de la langue.
18En lien avec de possibles réformes, Anne Dister et Marie-Louise Moreau portent une attention particulière aux consonnes doubles qui apparaissent comme l’une des difficultés majeures de l’orthographe du français. Elles ont analysé les réussites et les erreurs appliquées à ces consonnes doublées dans un corpus comprenant plus de 11 000 dictées d’élèves en fin d’école primaire. Elles proposent ainsi de distinguer les phénomènes de doublement de la consonne quand celui-ci est lié à la prononciation de la consonne ou de la voyelle qui précède. Les autrices ont également observé les résultats obtenus avec les mots écrits comportant une double consonne non légitime. Ces observations sont mises en relation avec d’autres variantes qui apparaissent dans les appariements phonographiques, et dans le cas où d’autres règles orthographiques perturbent ces relations élémentaires. En lien avec les résultats obtenus, l’étude se prolonge par des propositions réalistes de réforme des consonnes doubles.
19Pour clore l’ensemble, Christian Surcouf pose la question – un rien provocatrice – de ce qui pourrait justifier le maintien, à l’écrit, de marques d’accord dont la pratique orale de la langue ne rend pas compte. Son propos repose sur une conception phonographique de l’écrit, qui ramène les marques de genre et de nombre visibles mais inaudibles à des traces d’états anciens de la langue où précisément on les entendait, ce qui en justifiait la scription. Ce point de départ lui permet d’interroger l’existence même de l’accord en genre et nombre en synchronie, pour arriver à dire que l’accord n’est plus systématique en français contemporain. L’auteur analyse les travaux de grammaire comme prenant appui avant tout sur l’écrit, porteur de marques d’accord qui pour la plupart sont inaudibles. C’est la vision même de la langue qui, selon lui, est imprégnée des normes écrites. À travers l'articulation systématique d’une « orthographe normée » et de « fonctionnements langagiers » (i.e. oraux), la contribution questionne finalement la notion de linguistique de l’écrit, résonant de fait sur l’existence même de notre revue.
20En conclusion de cette présentation, nous ne saurions trop insister sur l’opportunité de recherches étendues à des corpus représentatifs qui permettraient de décrire quantitativement les différentes catégories de difficultés orthographiques. De telles études auraient un impact important sur la connaissance de la manière dont les scripteurs comprennent le fonctionnement de la langue, et partant, peut-être, sur la description même de ce fonctionnement. Dans le domaine de l’enseignement de l'écriture, où l’orthographe a une place singulière, la prise en compte de la réalité des traits orthographiques dans ses usages contemporains, y compris non standards, prolongeraient les travaux exposés dans ce volume, pour amoindrir les contraintes pesant sur la maitrise de procédures élémentaires comme la segmentation en mots, la maitrise des relations phonogrammiques ou la distance hétérographique des homophones ; mais aussi et surtout pour alléger le poids d’une morphographie grammaticale, notamment dans la maitrise des accords catégoriels en nombre, genre et personne, qui opposent souvent des raisonnements sémantiques et syntaxiques, compris dans des cotextes largement inaudibles. En complément, il faudra continuer à analyser des données plus qualitatives, à partir de justifications et d’explications recueillies auprès de publics contrastés, tant en termes d’âge ou d’expertise que de compétences métagraphiques. Ces données permettront, entre autres, de distinguer les erreurs relevant d’une méconnaissance de l’orthographe de celles liées à sa gestion dans le processus rédactionnel.
21Et pour aider à surmonter les problèmes orthographiques auxquels se heurtent tous les apprentis scripteurs-rédacteurs, il conviendra de poursuivre d’autres recherches d’ordre phylogénétique en comparant les systèmes d’écriture et leur histoire, à l’exemple de la diachronicité du français qui révèle des distorsions dommageables, notamment dans les usages oraux opposés à ceux de l’écrit. Nous pourrons alors, enfin, avancer résolument vers une réforme raisonnée de notre orthographe française, qui génère tant de difficultés et que nulle autre orthographe ne concentre.
- 1 Des Français, et non de l’ensemble des francophones, puisque d’autres communautés tentent d’officialiser des simplifications et des régularisations qui vont souvent au-delà de ce que les Français et leur Académie refusent, notamment sur les accords des participes (Dister 2024).
- 2 Historiquement, il faudrait prendre en compte toutes les études (sous la forme de précis, remarques, critiques et réponses) qui ont été publiées avant et après la création de l’Académie française (1634) et les éditions successives de ses dictionnaires ; mais aussi les débats des deux siècles derniers, en lien avec la mise en place des écoles publiques et de l’obligation scolaire (des années 1880), jusqu’aux décrets ministériels suggérant des tolérances pour les examens et concours, en 1901 et 1977, et les Rectifications de l’orthographe de décembre 1990.
- 3 Le même déséquilibre a été entériné par l’industrie du livre (Chartier 1997), dont l’objectif majeur est de faciliter l’accès au sens des textes en assurant une lisibilité orthographique sans contresens.
- 4 C’est ce que montrent nombre de recherches sur l’acquisition de l’orthographe, comme celles présentées dans les synthèses réalisées par Fayol et Jaffré (2008; 2014).
- 5 En corolaire, cette distinction des unités linguistiques, qui distinguent les deux ordres de l’oral et de l’écrit, permet d’étudier d’autres unités, comme celles plus strictement graphiques de la ponctuation et de la typographie (voir, entre autres, Pétillon, Rinck et Gautier 2016).