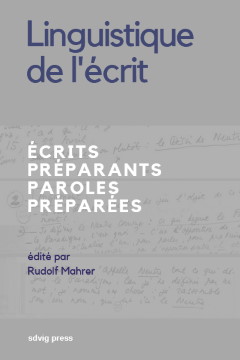Remerciements
1J’adresse mes remerciements à Madame Françoise Bérard, directrice de la bibliothèque de l’Institut de France, pour l’autorisation qui m’a été accordée d’exploiter le fonds Ferdinand Brunot. Mes remerciements vont également au personnel de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne pour m’avoir donné accès aux papiers Arsène Darmesteter ainsi qu’à celui du Grand équipement documentaire du Campus Condorcet qui conserve le fonds Gaston Paris.
1 | Introduction
2Parmi les archives de chercheurs (Bert, 2014), nombreux sont les écrits produits en vue d’un enseignement. Les notes de cours, qui appartiennent à cet ensemble, révèlent l’importance et la spécificité de l’activité pédagogique au sein des pratiques savantes depuis les années 1860 et « l’émergence des universités modernes » en France (Weisz, 1983). Cette période est en effet celle d’une évolution provoquée notamment par le rapprochement des activités savantes et enseignantes. Ceci se traduit par l’ouverture de nouveaux cours, de plus en plus spécialisés, pour lesquels il n’existe souvent pas encore d’ouvrages de référence, de traités scientifiques ni de manuels universitaires. Dans ce contexte, on peut, en première analyse, considérer les notes de cours comme des genres du discours, c’est-à-dire la combinaison de technologies (supports et instruments d’écriture) qui conditionnent la production et la transmission du savoir, et de textes, au sens d’une organisation verbale répondant aux besoins d’une pratique sociale.
3Pourtant, dans le cadre d’un enseignement dispensé oralement, ce n’est pas sous forme écrite que le savoir a vocation à être diffusé. On est alors en droit de concevoir les notes comme des manuscrits de travail, des brouillons – au sens que prend ce terme en génétique textuelle (Lebrave, 1983 ; Mahrer, 2009) – ou, parce qu’elles préparent une performance orale, comme des avant-dire (Philippe, 2014). Les appréhender de ce point de vue implique, d’abord, de s’interroger sur l’unité formelle et discursive – au-delà d’une identité thématique – que construit l’enseignant en écrivant ses notes en vue d’un « parcours complet d’un domaine du savoir » (Bruter 2008 : 13), autrement dit d’un cours. Cette approche nécessite, ensuite, de réfléchir à la manière dont l’enseignant inscrit dans ses documents, qui résultent d’une activité d’écriture individuelle, l’actualité d’un cours, situation dialogique régulièrement réitérée, face à un public similaire d’une séance à l’autre.
4De fait, comme le rappelle Josiane Boutet (2011), les notes de cours, de même que tous les écrits professionnels d’enseignants, ne peuvent s’envisager de manière décontextualisée, hors des situations de travail réelles qui conditionnent l’énonciation professorale. Leur fonction, essentiellement didactique, signifie non seulement qu’elles concourent, en tant qu’écrits, à l’activité d’enseignement dans le cadre d’un cours, mais aussi qu’elles portent simultanément la trace des trois éléments qui composent tout système didactique : l’enseignant, les apprenants – élèves, auditeurs, étudiants – et l’objet d’enseignement (Daunay, 2011).
5On s’interrogera ici sur la manière dont l’enseignant tente, dans ses notes de cours, de conjuguer les conditions qui déterminent son enseignement oral : un savoir à enseigner, un public aux objectifs plus ou moins clairement définis, des injonctions quant aux méthodes à mettre en œuvre et des contraintes matérielles et temporelles. C’est dans une double perspective, didactique et historique, qu’on abordera, en premier lieu, le rapport que les notes de cours entretiennent avec le moment et la pratique de l’enseignement oral face aux étudiants. Cet éclairage permettra, dans un second temps, de comparer les pratiques d’écriture en vue d’enseigner de trois linguistes ayant exercé, simultanément ou successivement, dans des établissements de l’enseignement supérieur parisien (ou, du moins, francilien) de la fin du XIXe et au début du XXe siècle : Gaston Paris, Arsène Darmesteter et Ferdinand Brunot1.
2 | Les notes de cours : temps didactique, temps historique
2.1. Les notes de cours, une mise en texte du savoir ?
6Parce que le cours est constitué d’un ensemble de séances réparties selon un rythme régulier – souvent hebdomadaire –, sur un intervalle de temps défini – généralement un semestre ou une année –, les notes de cours, à la différence d’écrits préparatoires à un exposé scientifique ponctuel devant un public de spécialistes ou à un discours politique, relient étroitement la prise en compte de la visée formative du cours et la segmentation du savoir dans le temps. Cet aspect entre directement dans le champ d’étude des didacticiens.
7Parmi les approches possibles de l’élaboration des contenus d’un enseignement, la notion de transposition didactique, initialement proposée par le sociologue Michel Verret pour décrire la « distribution temporelle des activités des étudiants » en sciences humaines et sociales (1975 : 1) 2, puis reprise et généralisée par le didacticien des mathématiques Yves Chevallard (1991) [1985], renvoie à l’élaboration d’un savoir propre à l’enseignement à partir d’un autre, préexistant, qu’on pourrait qualifier de scientifique, de savant ou de référence. La transposition didactique se caractérise par cinq opérations touchant le savoir et sa transmission (Verret 1975 : 146) :
- la désyncrétisation du savoir, autrement dit son découpage en éléments enseignables ;
- la programmation de son acquisition dans le temps ;
- la dépersonnalisation, c’est-à-dire la séparation du savoir de la personne qui l’a élaboré ;
- la publicité du savoir, soit sa définition explicite en tant que savoir à enseigner ;
- la possibilité de vérifier l’acquisition du savoir ou contrôle social des apprentissages.
8Or, pour Chevallard, ces opérations « sont tendanciellement satisfaites par un processus d’“apprêt” didactique » (1991 : 58), processus qu’il nomme également mise en texte (ou textualisation) du savoir3. Il attribue au texte du savoir des propriétés didactiques essentielles.
Le texte est une norme de progression dans la connaissance. Un texte a un début et une fin (provisoire), et opère par un enchaînement de raisons. Si l’apprentissage est conçu comme une marque du progrès que manifeste la structure propre du texte, celui-ci permet la mesure de celui-là ; et permet surtout une didactique “isomorphe” dont il marque les scansions. C’est, me semble-t-il, de ce point qu’il faut partir afin de poursuivre l’analyse : le texte autorise une didactique, dont la durée démarque sa diachronie, et cette didactique se légitime alors par la fiction d’une conception de l’apprentissage comme “isomorphe” au procès d’enseignement dont le modèle ordonnateur est le texte du savoir en sa dynamique temporelle. (Chevallard et Johsua 1991 : 62)
9Le texte du savoir confère au contenu enseigné une forme à la fois segmentée et progressive qui permet de le délimiter, de l’isoler dans l’ensemble des savoirs existants et, par suite, de le transmettre. « Le texte a un début, et il procède séquentiellement. Cela déjà n’est pas vrai du savoir que le texte porte à l’explicitation discursive » (Chevallard et Johsua 1991 : 62). Ainsi considéré, le texte du savoir est le lieu de la construction discursive d’un objet d’enseignement à partir d’un savoir préexistant qui s’en trouve transformé, transposé4. Par sa séquentialité, il ordonne le temps de l’enseignement. De là, Chevallard conclut que « le processus didactique existe comme interaction d’un texte et d’une durée » (1991 : 65).
10En réalité, cette durée didactique est multiple, d’où la notion de chronogenèse, que Chevallard associe à la transposition didactique. « Diachronie du système didactique » (1991 : 72), la chronogenèse est l’organisation temporelle de l’écart entre le savoir de l’enseignant et celui de ses élèves : le premier connaît déjà l’objet de savoir avant le cours ; il en sait plus long sur cet objet que le contenu du cours ; et il est en mesure d’anticiper le temps didactique. Reuter & al. explicitent les enjeux de cette notion de la façon suivante (2013 : 9) :
La chronogenèse permet de poser la question des temporalités différentes qui régissent la relation didactique. Trois organisations de savoir au moins peuvent être distinguées : celle qui préside à la mise en texte du savoir (avant l’enseignement), celle qui permet de programmer le savoir à enseigner (dans la préparation de l’enseignant), celle qui décrit le savoir enseigné (dans le déroulement du cours). Ces trois organisations génèrent sans doute des ordres temporels différents, c’est du moins une hypothèse de travail pertinente qui semble à explorer.
11Le savoir ne se présente pas sous la même forme dans les programmes et les manuels qui constituent sa mise en texte, dans les écrits préparatoires des enseignants – leurs notes de cours – qui sont donc postérieurs à cette mise en texte et dans l’enseignement dispensé oralement. À chacune de ces modalités d’organisation du savoir correspondrait une temporalité didactique. Chevallard parle du temps didactique légal (ou officiel), norme fixée par l’institution, qui s’impose à l’enseignant (1991 : 83) : ce temps prescrit serait celui du texte du savoir. Le temps fictif, à la fois progressif et cumulatif, que l’enseignant doit anticiper pour mettre en œuvre son enseignement serait celui qu’il élaborerait dans ses notes préparatoires. Enfin, la pluralité des temps de l’apprentissage du savoir, hétérogènes aux deux précédents, laisserait une place aux écarts, aux retours en arrière nécessaires à l’appropriation des savoirs.
12Les notes de cours appartiendraient-elles donc exclusivement à la seconde temporalité ? Le texte tel que le définit Chevallard dans une perspective didactique n’est pas un texte, mais un ensemble de textes relevant de genres divers, produits par des auteurs aux statuts différents et s’adressant à des publics partiellement hétérogènes, tels que les programmes d’enseignement, les documents d’accompagnement à leur mise en œuvre, ou encore les manuels scolaires. Or c’est bien parce qu’il prend des formes langagières, linéaires, que le texte organise le savoir de manière à rendre possible une didactique. Pourtant, la notion de texte du savoir, conçue exclusivement du point de vue du savoir en tant que contenu et non en rapport aux genres de discours ou du point de vue de sa forme, n’en présente pas moins l’intérêt, grâce à la multiplicité des temporalités qu’elle englobe, d’offrir une entrée pour interroger le lien entre la continuité discursive de textes susceptibles de constituer un texte du savoir et l’actualisation du savoir par l’enseignant en vue de permettre un apprentissage. Plus précisément, dans la perspective d’une analyse des notes de cours en tant que produits d’un processus d’écriture, les envisager comme texte du savoir permet de mettre en relation les différentes chronologies dont elles relèvent.
13En tant qu’écrits de préparation (Mahrer & Nicollier Saraillon 2015 : 206), les notes de cours possèdent une fonction instrumentale vis-à-vis de l’enseignement oral, ce qui ne les empêche pas d’endosser d’autres rôles à l’endroit du savoir dont elles sont porteuses. Les cantonner à la deuxième des temporalités précédemment décrites, celle de la programmation du savoir à enseigner dans la préparation de l’enseignant, serait réducteur. En témoigne Jeanne Streicher, ancienne élève de Ferdinand Brunot à l’École Normale Supérieure (désormais ENS) de Sèvres, qui raconte que
le cours de M. Brunot à Sèvres pendant plus de vingt ans, n’a cessé d’être une genèse. Quand il écrivait son Histoire de la langue française classique, ce sont les chapitres sur la syntaxe qu’il apportait tout chauds de la récente coulée, et que parfois il retouchait ou polissait avec ses élèves ; devant elles, il élaborait un Abrégé de l’histoire du français, qu’il a renouvelé sur tant de points. (Streicher 1932 : 253)
14À en croire ce récit, les écrits que Brunot avait sous les yeux au moment d’enseigner cumulaient trois fonctions : outre le fait de servir d’appui au cours fait oralement devant les Sévriennes, ils sont aussi le fruit de l’élaboration d’un savoir savant – celui de l’historien de la langue française – et la préparation d’un manuel voué à fixer le texte du savoir dans son domaine de spécialité5. Le face à face avec les élèves constitue-t-il une étape intermédiaire entre les deux projets éditoriaux, une phase d’une transposition didactique qui s’opère de l’un à l’autre ? Ou bien s’agit-il de deux périodes distinctes de la carrière de Brunot à Sèvres (1900-1925), où l’écriture des notes de cours et l’activité d’enseignement se présenteraient, d’une part, comme l’opportunité de mettre à l’épreuve un aboutissement – temporaire – de sa pensée, et, d’autre part, comme la possibilité d’entamer un nouveau projet éditorial ? Ce qu’en dit Streicher ne permet pas de le déterminer. Toujours est-il que savoir savant et savoir enseigné paraissent, dans ces conditions, bien difficiles à circonscrire, ce d’autant que le savoir que Brunot dispense à ses élèves de Sèvres est profondément lié à la fois à sa propre pensée et à la disciplinarisation (Chiss & al., 2012) de la langue française comme objet d’étude, scolaire et universitaire6.
15Le témoignage de Streicher met aussi en lumière la grande liberté dont semble jouir Brunot dans la manière de concevoir son cours pour les Sévriennes. Quid alors de la programmation du savoir, conditionnée par le rythme et la durée des séances et, au-delà, de la prise en compte de l’actio du cours ? Reste alors à saisir à quel point les conditions institutionnelles de l’enseignement pèsent sur l’écriture des notes de cours.
2.2. Cours magistral, séminaire, conférence : préconisations institutionnelles et pratiques effectives
16Dans l’enseignement, « la marge de liberté dont dispose le professeur est […] variable non seulement en fonction des circonstances, mais aussi de sa personnalité propre » (Bruter 2008 : 53). Les notes de cours participent donc d’une histoire des pratiques d’enseignement prescrites qu’il convient de mettre en regard des pratiques effectivement constatées afin de mieux comprendre la manière dont ces notes pouvaient être utilisées par les enseignants eux-mêmes.
17Contrairement à ce que pourrait laisser penser le singulier du terme, le cours magistral n’est pas uniforme à la fin du XIXe siècle. On distingue alors le cours parlé – qu’on qualifierait aujourd’hui de dialogué –, plutôt valorisé, en particulier dans l’enseignement secondaire7, et le cours dicté (Héry 2015 : Chap. 3 §28‑44), dont l’abolition est préconisée, surtout dans l’enseignement littéraire, à partir des années 1890 (Chervel 2006 : 761‑762). À cette première distinction s’ajoute, dans les facultés, celle qui existe, à partir de la création des premières bourses de licence en 1877, entre cours réservés (aux étudiants) et cours publics. En effet, tout au long du XIXe siècle et encore dans le premier tiers du XXe siècle, les cours publics s’adressent à des auditeurs qui ne sont pas toujours inscrits pour suivre des études et préparer un diplôme : l’assiduité et la volonté d’acquérir des savoirs de haut niveau ne les caractérisent donc pas nécessairement8. Or plusieurs mesures, telles que la fondation de l’École Pratique des Hautes Études en 1868 par le ministre de l’Instruction publique français, Victor Duruy, attestent justement de la volonté de transformer l’enseignement supérieur en créant, comme le formulent les historiens Christophe Charle et Jacques Verger,
des laboratoires liés à l’enseignement et un lieu où l’on transmet la science sous forme de séminaires spécialisés rompant avec le cours formel destiné au grand public, principal mode d’enseignement dans les facultés. (2012 : 110)
18À la différence des cours magistraux dispensés dans les facultés, l’enseignement proposé à l’EPHE doit être « pratique ». C’est pourquoi il est organisé sous forme de conférences, soit des petits groupes d’élèves directement formés à la production de nouveaux savoirs sous l’égide d’un directeur d’étude. Celui-ci mène la discussion collective autour des travaux présentés par les élèves eux-mêmes. La conférence, dans ce sens, est une forme d’adaptation du Seminar allemand et s’oppose à la leçon magistrale ex cathedra9. Pour autant, la pratique n’était pas toujours conforme à ce schéma : le résumé pour l’année 1875-1876 de la Conférence des langues romanes de l’EPHE, où Arsène Darmesteter est le répétiteur du directeur d’études, Gaston Paris, révèle que Darmesteter pratique le cours magistral dicté, a priori incompatible avec les attentes institutionnelles : « pendant le second semestre, les élèves n’ont pas fait de travaux spéciaux ; ils ont résumé à tour de rôle les leçons dictées à chaque conférence » (Paris & Darmesteter, 1876).
19Les conférences sont étendues aux facultés – dont celles des lettres – en 1877, quand est créé le statut de maître de conférences, en complément de celui de professeur10. Enfin, ce même terme de conférence existe aussi à l’ENS de la rue d’Ulm puis, dès sa fondation en 1881, également à celle de Sèvres, réservée aux femmes11. Dans ce dernier établissement, il doit officiellement se réduire à un « enseignement de résultats et de conclusions », selon le mot d’Octave Gréard, vice-recteur de l’Académie de Paris (1889 : 224). Or le témoignage d’une Sévrienne, ancienne élève de Darmesteter, montre qu’il pratiquait là aussi le cours dicté sans se priver ni d’improviser ni, surtout, de développer sa pensée savante pendant le cours.
La grammaire de Monsieur Darmesteter avait pour moi moins d’attraits [que les cours de littérature, histoire et géographie], et ses longues dictées m’ont paru bien des fois fastidieuses ; mais quand, oubliant “le cours” il se mettait à penser tout haut devant nous, quelles envolées ! Nous comprenions alors tout ce que comporte d’imagination, de poésie même, cette science qui nous paraissait si ardue en temps ordinaire, et quel esprit puissant, quel cœur sensible habitaient ce grammairien distrait et absorbé. (Anne Saussotte-Rollot in Streicher 1932 : 229)
20La pratique du cours magistral dicté se traduit, dans les notes de cours de Darmesteter par une quantité importante de feuillets entièrement rédigés, destinés à toutes les institutions où il a exercé : EPHE, Sorbonne, ENS de Sèvres. La transversalité des pratiques d’enseignement et la liberté de fixer le contenu soi-même autorisent le transfert non seulement des notes elles-mêmes, mais aussi des pratiques d’écriture, d’un cours à l’autre et entre établissements. Pour autant, même au sein de ces ensembles de feuillets, l’usage exact qu’en faisait l’enseignant face à ses étudiants n’est pas toujours évident.
21Inscrites dans l’actualité d’une pratique sociale – l’enseignement – déterminée, à partir de la fin du XIXe siècle, par des injonctions politiques qui débordent les institutions d’enseignement prises séparément, les notes de cours relèvent également de choix personnels de la part de l’enseignant quant à la forme à donner à son cours. Parce qu’il est aussi un savant, le savoir de l’enseignant procède d’une continuité entre les deux facettes de son activité professionnelle. Apparaît alors l’existence d’une imbrication, spécifique à l’enseignement supérieur, de l’élaboration du savoir par l’écriture, de sa planification écrite en vue d’enseigner et de son oralisation dans le face à face pédagogique. À ces temporalités didactiques, il convient d’ajouter celle, biographique, de la carrière de l’enseignant.
3 | Savoirs linguistiques, objectifs didactiques et conditions d’enseignement
22Trois exemples de notes de cours respectivement tirées des archives de Gaston Paris, d’Arsène Darmesteter et de Ferdinand Brunot permettront de mettre en lumière la manière dont ces linguistes, dans leurs écrits, élaborent des savoirs savants tout en les inscrivant dans des situations d’enseignement, chacune ancrée dans le contexte où se déroule leur cours.
3.1. Segmenter le savoir, organiser le cours : Gaston Paris et l’histoire des sons de la langue française
23Entre 1867 et 1869, Paris, alors enseignant débutant, participe aux Cours libres de la rue Gerson, institution d’enseignement supérieur autorisée par le ministre Duruy. Celui-ci charge un inspecteur, Eugène Garsonnet, de les visiter. Il fait le rapport suivant du cours de Paris en janvier 1869.
J’ai entendu de lui une leçon tout à fait remarquable sur l’Histoire des sons de la langue française. Il a d’abord exposé la doctrine de Palsgrave, puis il a lu et commenté un dialogue de Ramus tout à fait curieux sur la prononciation, la quantité, l’accent... enfin il a raconté d’une manière vraiment piquante l’essai malheureux fait au 16e siècle par les poètes de la Pléiade de Ronsard pour naturaliser en France les vers hexamétriques et pentamétriques, la strophe saphique ou alcaïque etc. etc.
24À quelle leçon l’inspecteur a-t-il assisté ? Les notes de Paris, intégralement rédigées, se trouvent dans des cahiers dont il exploite chaque page presque sans laisser de marge. La huitième leçon, datée du 5 janvier 1869, soit quatre jours avant le rapport de Garsonnet, coïncide avec le début d’une nouvelle partie du cours (Figure 1).


25Cependant, aux dires de Garsonnet, Paris aurait commencé la leçon par traiter de Palsgrave ; or ce nom n’apparaît dans les notes que deux pages et demie plus loin. L’inspecteur a-t-il simplement omis de mentionner le début de la leçon qu’il a observée ? Cela semble peu vraisemblable : tous les contenus que relate l’inspecteur figurent bien dans les notes de cours de Paris. En revanche, la matière est répartie entre la huitième leçon, celle du 5 janvier, et la neuvième leçon, datée du 8 d’après les notes de Paris. L’enseignant ne semble donc pas avoir respecté le découpage en leçons qu’il s’était lui-même fixé.
26Le temps didactique planifié, s’il ne correspond pas au rythme de l’enseignement oral, ne s’accorde pas non plus avec l’organisation spatiale du cahier dans lequel écrit Paris, qui ne semble pas considérer la page comme un espace délimitant. De façon générale, il n’hésite pas à situer le début d’une nouvelle leçon au beau milieu d’une page, à la suite de la précédente, sans laisser de blanc plus important avant ou après. Bien que la matière de la leçon décrite par Garsonnet se termine au bas d’un feuillet, le cas est relativement rare et le feuillet suivant ne comporte aucune trace de division chronologique du cours mais uniquement l’intertitre « § 2. De l’accent ». La leçon que rapporte l’inspecteur ne semble donc correspondre ni à la segmentation hiérarchisée du savoir en tant que discours – Paris découpe son propos en livres, en chapitres, en sections –,13 qui procède de sa désyncrétisation, ni à sa répartition dans le temps de l’enseignement, soit sa programmation.
27Quel est alors l’intérêt de chacun de ces systèmes de segmentation et, partant, de leur superposition ? Ils semblent offrir deux types de points de repère. Pour Paris et pour ses auditeurs, la subdivision en sections hiérarchisées circonscrit le domaine de savoir à parcourir pour lequel il ne préexiste aucun manuel – aucun texte du savoir. Les dates de cours, destinées à Paris seul, paraissent plutôt constituer des jalons dans ses feuillets très densément remplis afin de mesurer l’avancée dans le contenu de ce cours vraisemblablement conçu pour être intégralement lu aux auditeurs. D’ailleurs, à la différence des titres et intertitres qui disposent toujours d’une ligne dédiée, elles s’insèrent fréquemment dans les espaces restés libres après la rédaction du texte (Figure 2) ou dans les rares espaces marginaux (Figures 3 et 4).






28Bien que débutant, l’enseignant a conscience de l’inévitable écart entre la planification de l’enseignement et la pratique. Il constate, dès l’introduction de ce cours que, l’année précédente, il a « été amené par la pratique à entrer dans plus de détails [qu’il] ne l’avai[t] prévu […] » (fo 13vo). Pour autant, bien qu’il continue à indiquer des dates, il n’envisage à aucun moment de faire primer l’adéquation du contenu au cadre temporel imposé par l’institution sur son objectif de formation. Il affirme d’ailleurs que
les faits peuvent s’apprendre dans les livres ; mais c’est à l’enseignement oral seul qu’il appartient de donner <communiquer>, par l’application incessante, l’ensemble des procédés critiques qui constituent la méthode propre à chaque recherche. Pour travailler, le meilleur enseignement, sera toujours de voir travailler. (fo 14ro)
29Il semble qu’Arsène Darmesteter, auditeur de Paris rue Gerson, ait choisi de mettre en pratique les conseils de son maître dans son propre enseignement. C’est du moins ce que laissent penser ses notes de cours.
3.2. Former à la méthode scientifique : Arsène Darmesteter et les listes de mots en emploi autonyme
30Dans les notes d’un cours sur le « latin populaire » dispensé en 1881 à la Sorbonne, Darmesteter commence par définir l’objet et le plan de la première section (consacrée au « lexique du latin populaire vers la fin de l’Empire à la naissance des langues romanes ») puis entre dans le vif du sujet ainsi :
Nous classons dans un ordre méthodique les mots du latin classique disparus de l’usage populaire, bien que nombre de ces mots dès le plus ancien français, bien que nombre de ces mots ait reparu dans la langue savante sous la plume des écrivains.
31Suivent alors huit pages de listes de mots en emploi autonyme, des lexika. L’ordre méthodique annoncé est une hiérarchie à deux niveaux. Le premier est formé par les parties du discours auxquelles appartiennent les mots listés : substantifs, adjectifs et verbes. À l’intérieur de chacune de ces catégories, les mots sont groupés par champ lexical pour les substantifs et par paradigme de conjugaison pour les verbes (Figure 5). Au sein de chacune de ces listes de noms ou de verbes, de même que pour les adjectifs, qui sont moins nombreux, les mots sont rangés par ordre alphabétique.


32À quel type d’oralisation une telle quantité de mots listés a-t-elle pu donner lieu ? Darmesteter les dictait-il simplement comme le reste du cours ? Faisait-il usage d’un tableau noir pour les recopier, éventuellement en les lisant à voix haute ? Les commentait-il au fur et à mesure ? Attendait-il des étudiants qu’ils les prennent en notes ? Si leur visée didactique reste difficile à définir, il apparaît en tout cas que ces lexika font partie intégrante du cours. En attestent justement les notes de Darmesteter, qui poursuit, deux lignes plus bas :
Ces listes sont loin d’être complètes ; on pourrait facilement les doubler et les tripler. Qu’en conclure ? Que le roman est moins riche que le latin ? Une telle conclusion n’est pas légitime : il est nécessaire de poser autrement les faits.
33Tant la localisation relative de la dernière liste et de ce paragraphe sur la feuille que le déterminant démonstratif « ces » dans la première phrase et l’emploi anaphorique du pronom « en » dans la seconde montrent que les listes qui précèdent sont un segment pleinement intégré aux notes de cours et ce, malgré leur longueur. Celle-ci n’est pourtant pas triviale. En effet, l’intégration de listes aussi longues aux notes de cours n’est pas une pratique que partagent tous les linguistes. Paris, pour sa part, a plutôt tendance à limiter le nombre de termes, généralement à trois, quatre ou cinq, puis à ajouter « etc. », c’est-à-dire à privilégier « l’effet-liste » à la liste elle-même (Rabatel, 2011), autrement dit l’identification de l’ouverture d’un paradigme au sein de son discours, d’une part, et la facilité d’oralisation, d’autre part. Les listes ne semblent pas remplir la même fonction chez les deux enseignants. Tandis que Paris illustre simplement son propos, Darmesteter, tout en se défendant de toute exhaustivité, montre à ses étudiants sur quoi s’appuie son raisonnement : ses listes ont une valeur démonstrative.
34Ayant choisi le lexique du latin populaire pour objet d’étude, Darmesteter, parce qu’il l’étudie d’un point de vue historique, cherche à matérialiser une évolution et, en l’occurrence, une absence : celle des mots du latin classique qui ne sont plus attestés en latin populaire. Il s’agit là de rendre visible l’invisible, autrement dit d’élaborer un savoir nouveau, impossible à repérer autrement, et d’ordonner ce savoir en séries. Une telle démarche ne peut intervenir qu’après un travail préalable de comparaison de documents attestant des deux états de langue et un relevé linéaire des formes présentes dans les uns et absentes dans les autres. Sur quels documents Darmesteter s’est-il fondé ? Dans d’autres notes de cours du même fonds, il décrit les sources qui donnent accès au latin populaire et fait en particulier mention des glossaires de l’époque mérovingienne.
35Quoi qu’il en soit, « l’ordre méthodique » décrit plus haut ne peut exister que dans un second temps : le contenu de ces notes de cours, sélectionné et organisé, est donc un résultat, à replacer dans une suite de gestes professionnels effectués par un linguiste. En cela, on peut parler, avec Irène Fenoglio (2012), de geste linguistique : l’écriture et la mise en texte de ces lexika joue ici un rôle heuristique pour Darmesteter lui-même. Ainsi, le savoir que portent ses notes est pris dans une double dynamique : celle des interactions au sein d’un système didactique où il est objet d’enseignement-apprentissage et celle de sa propre construction, par l’écriture, ancrée dans un contexte épistémologique spécifique, celui de la grammaire historique de la fin du XIXe siècle.
36Ferdinand Brunot, qui succède – indirectement – à Darmesteter à la Sorbonne, prend également sa suite à l’ENS de Sèvres à partir de 1900. Il y introduit de nouveaux savoirs dont ses notes de cours reflètent la spécificité.
3.3. Donner à voir, donner à entendre : Ferdinand Brunot et l’enseignement de la phonétique expérimentale
37Les notes de cours de Ferdinand Brunot pour un cours de phonétique dispensé aux élèves de l’ENS de Sèvres, vraisemblablement produites entre 1909 et 1911,14 montrent qu’il utilise en classe des instruments afin de faire des démonstrations : palais artificiel, signal du larynx, pneumographe, disques... (Figure 6)


38Brunot utilise la marge gauche pour indiquer, à l’aide du symbole +, les moments où il lui faut utiliser les instruments. À chaque « + » correspond, dans le corps du texte, une description des démonstrations à effectuer : pour le palais artificiel, « une ou deux applications » ainsi que des exemples de « son insuffisance ». Le soulignement des lettres marque qu’elles ont ici une valeur phonétique. Quand il s’agit non de manipuler un instrument mais de faire écouter un enregistrement, Brunot a recours à des indications langagières comme « disque de sourds muets ».
39Cette pratique appelle plusieurs remarques. D’abord, elle révèle que les notes de cours, par des indices plurisémiotiques, peuvent porter la trace de la multimodalité de l’échange avec les étudiants ainsi que du matériel présent dans la salle au moment du cours. D’autres manuscrits présents dans le fonds et produits par d’autres scripteurs qui ont assisté aux cours, notamment des Sévriennes, témoignent également du fait que Brunot utilisait le tableau pour dessiner par exemple. Les auditeurs eux-mêmes étaient invités à dessiner, au moins de façon schématique, les machines et instruments montrés. En permettant à Brunot d’anticiper les actions à réaliser au moment d’enseigner, les notes de cours remplissent bien leur rôle d’« espace de la préperformance » (Mahrer 2014 : § 59-62). Elles apparaissent en cela spécifiquement comme des avant-dire. Ensuite, d’un point de vue plus directement didactique, ces notes permettent de pointer l’interaction entre la thématique du cours et les pratiques d’enseignement de Brunot : la phonétique dont traite alors le linguiste, parce qu’elle est expérimentale, nécessite le recours à des supports audio et à des instruments. De là découle la troisième remarque : les notes de cours sont profondément ancrées dans la réalité des savoirs et des pratiques savantes de l’enseignant lui-même. Brunot est le fondateur, justement en 1911, des Archives de la Parole, qu’il mentionne dans ses notes. Il donne une place dans son cours et dans ses notes à des machines très récentes, comme le pathégraphe15.
40D’autre part, si l’on observe la partie principale des notes, qui sont semi-rédigées, Brunot utilise peu d’abréviations, mais multiplie les phrases non verbales, constituées le plus souvent de syntagmes nominaux ; il s’agit là d’une séquence principalement descriptive. Par ailleurs, on peut souligner, dans les phrases verbales, l’usage quasi-exclusif du présent de l’indicatif. Deux exceptions néanmoins : l’impératif présent « remarquez » et le futur périphrastique dans « vous allez en juger », qui rappellent qu’il s’agit d’un enseignement à vocation « pratique », qui s’adresse à des professeures de français en formation. Brunot les invite d’ailleurs à se projeter dans leur futur métier quand il écrit, à propos du palais artificiel : « En outre votre élève n’en a pas ». Enfin, tout au bas de la page, dans « on ne saurait prendre des acteurs », le pronom « on », dont la valeur semble plutôt indéfinie que personnelle – Brunot n’hésite pas à écrire « je » dès le feuillet suivant –, et la modalisation portée par la forme négative du verbe savoir au conditionnel présent, indiquent un commentaire métadiscursif qui vise à insister sur la légitimité du projet des Archives de la Parole et à anticiper la disqualification de « l’horrible diction théâtrale » aux feuillets suivants.
41Le cours pour lequel ont été produites ces notes est visiblement magistral : Brunot, en tant qu’enseignant, est celui qui prend en charge l’exposé et qui effectue les gestes qui lui sont associés. Pour autant, dans l’écriture de ses notes de cours, Brunot établit un continuum à plusieurs niveaux : entre son activité dans et hors de la classe ; entre son travail de savant et celui d’enseignant ; entre son propre enseignement et celui que seront amenées à dispenser ses élèves ; et, enfin, entre le matériel, le gestuel et le verbal. Ces notes comportent ainsi des informations précieuses quant aux pratiques d’enseignement mises en œuvre par Brunot à Sèvres, pour des jeunes femmes dont la formation était pourtant censée s’en tenir à des « conclusions et [des] résultats ».
4 | Conclusion
42Fruits de pratiques idiosyncrasiques, que ce soit dans la manière de se saisir du cadre matériel et institutionnel du cours et d’y construire l’espace dialogique avec les étudiants ou dans la définition et l’agencement des savoirs à enseigner, eux-mêmes indissociables des travaux savants menés parallèlement par l’enseignant, les notes de cours sont aussi les produits de processus sociaux. À la croisée de temporalités multiples – archivistique, historique, biographique, épistémique, didactique, génétique –, elles nécessitent de faire appel à des points de vue disciplinaires complémentaires pour être saisies en tant que productions langagières situées à la fois par rapport à l’enseignement oral en fonction duquel elles sont produites, d’une part, et par rapport au contexte institutionnel et épistémologique dans lequel elles s’inscrivent, d’autre part.
43Le processus de mise en texte qu’implique la transposition didactique passe par l’écriture et relève, dans cette mesure, de plusieurs temporalités. La première est celle de la segmentation chronologique du savoir, visible dans les notes de cours elles-mêmes. Souvent anticipée au moment de la préparation, cette segmentation est parfois aussi réévaluée, réécrite, pour réduire l’inévitable écart entre les attentes du professeur et le déroulement réel du cours. La seconde temporalité appartient à l’activité professionnelle, à la fois enseignante et savante, qui nécessite d’interroger les finalités réelles de chaque ensemble de notes de cours : le moment qu’un enseignant consacre à la préparation d’un cours n’est pas nécessairement distinct de celui qu’il réserve à la rédaction d’ouvrages à publier, qui peut lui-même se confondre avec celui où il enseigne oralement ; ces diverses phases restent souvent difficiles, voire impossibles, à ordonner chronologiquement. Enfin, troisième temporalité, cette écriture est parfois celle d’une carrière, qui peut aussi bien permettre le réemploi de notes anciennes16, que rendre nécessaire la production de nouvelles notes liées au développement de nouveaux champs d’investigation.
44Parmi les conditions qui déterminent l’écriture des notes de cours, la commande institutionnelle, en particulier quand elle porte sur les méthodes d’enseignement, semble souvent secondaire dans les préoccupations des enseignants pris individuellement mais significative sur un temps plus long. En effet, bien que la conception personnelle de ce qu’est un cours et les contraintes liées aux effectifs d’étudiants prennent fréquemment le pas sur l’injonction à développer des formations « pratiques », les pratiques d’enseignement ne restent pas figées. Des notes entièrement rédigées par Paris dans les années 1860 et encore par Darmesteter deux décennies plus tard, jusqu’aux notes semi-rédigées présentes dans les archives de Brunot datant des premières décennies du XXe siècle, le cours magistral dicté apparaît en recul. Dans le même temps, comme en témoignent les Sévriennes, devant lesquelles se sont succédé Darmesteter et Brunot à plus de dix ans d’écart, les libertés que s’autorisent les professeurs non seulement vis-à-vis des méthodes préconisées par l’institution, mais aussi de leur propre préparation semblent être une constante, indépendamment des formes que prennent leurs notes de cours.
- 1 Sur les liens entre les carrières de ces enseignants, v. (Jorge, à paraître). On emploiera ici le mot « linguiste » pour désigner toute personne prenant pour objet d’étude une ou plusieurs langues. Cet emploi ne préjuge pas de l’existence de la linguistique en tant que discipline constituée.
- 2 Verret s’intéresse plus précisément à la philosophie, la sociologie et la psychologie.
- 3 Cet aspect est très peu développé chez Verret.
- 4 Le texte du savoir tel que le définit Chevallard semble procéder d’une double mise en discours : celle du passage d’un ensemble de savoirs à un texte et celle de la transformation d’un discours savant en un discours didactique. Chevallard insiste en effet sur la distinction entre savoir et texte du savoir : le texte résulte d’une « réduction » (1991 : 84) des savoirs, ainsi délimités et structurés. D’autre part, l’auteur prend en compte l’existence d’un discours savant préalable à la transposition didactique : « certaines contraintes, qui interviennent dans l’apprêt didactique du savoir, sont en fait en œuvre dès la constitution du savoir savant, ou du moins dès la formulation discursive de ce savoir » (1991 : 21) : la mise en texte en vue d’enseigner s’apparente, dans cette mesure, à une reformulation.
- 5 Brunot n’a jamais publié le manuel en question, mais ses archives attestent de cette intention.
- 6 Sur ce point, v. notamment (Bergounioux 1998).
- 7 Il l’est en particulier par Michel Bréal, ce que souligne Bruter (2013).
- 8 C’est encore le cas après 1877, mais les cours réservés ou fermés, qui s’adressent exclusivement aux étudiants régulièrement inscrits, deviennent progressivement majoritaires. Sur ce point, v. (Prost 1968 : 224‑28).
- 9 V. (Waquet 2003 : 100‑112). Dans les Annuaires publiés depuis l’ouverture de l’EPHE, l’emploi du terme séminaire en lieu et place de conférence pour désigner ces enseignements ne se généralise que très tardivement, dans les années 1980-1990.
- 10 Le titre est créé par un arrêté du 5 novembre 1877. Arsène Darmesteter, qui soutient sa thèse le 13 décembre cette année-là est d’ailleurs l’un des premiers à occuper ce statut. Il reçoit le titre le 16 décembre.
- 11 L’existence de conférences à l’ENS de la rue d’Ulm procède d’une histoire différente. Sur ce point, v. (Hummel, 1995).
- 12 Une version numérisée de l’ensemble du manuscrit a été mise à disposition par l’EPHE à cette adresse : https://www.nakala.fr/11280/98dc7040 (Licence CC BY-NC-SA).
- 13 On retrouve ces mêmes termes dans les notes de cours de Darmesteter et de Brunot. On voit l’importance de la référence au codex, à tel point que parfois seul le titre général de la chemise ou de l’ensemble de feuillets ainsi que de rares indices discursifs permettent d’identifier qu’il s’agit bien de notes de cours et non d’un brouillon d’ouvrage à publier.
- 14 Cette datation s’appuie sur des résumés de cours rédigés par les élèves et datés de 1909, d’une part, ainsi que sur des éléments factuels cités par Brunot lui-même dans ses notes, tels que les Archives de la Parole fondées en 1911, ou le pathégraphe, créé la même année (v. infra note 15).
- 15 Le pathégraphe est un phonographe destiné à l’enseignement des langues vivantes, créé en 1911 par Ferdinand Brunot avec l’industriel Émile Pathé. Voir la notice de l’appareil conservé par la Bibliothèque nationale de France : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc97705f/ca19910707. Pascal Cordereix, conservateur responsable du service des documents sonores, présente le pathégraphe et le contexte de son invention dans cette vidéo : https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/le-pathegraphe-maitre-de-langues.
- 16 Sur ce point, v. (Jorge & Testenoire, 2017).