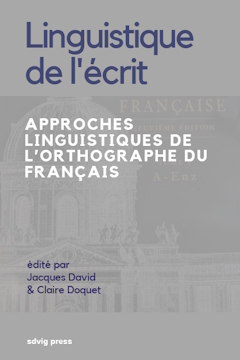1 | Introduction
1Récemment, avec l’adoption des rectifications orthographiques de 1990 dans les nouveaux moyens d’enseignement obligatoires pour le français en Suisse romande et la parution d’un guide officiel, Le Petit livre d’OR (CIIP 2021), explicitant 14 principes de l’orthographe rectifiée (OR) de 1990 et formulant une « règle d’or pour introduire le langage épicène », l’actualité régionale a été nourrie de débats sur la langue qui témoignent des rapports complexes que les francophones entretiennent avec leur langue. Ces recommandations en vue de l’intégration des rectifications orthographiques ou de l’introduction d’un langage épicène tentent de combler un déficit de normativité des décisions officielles (Siouffi 2019) ou, autrement dit, l’absence d’un discours prescriptif homogène qui place les usagères et usagers1 de la langue devant des interrogations.
2Engagées toutes deux dans la formation des enseignantes et enseignants du canton de Vaud, nous avons dû répondre à des demandes qui témoignent de leur désarroi : « Quelle orthographe enseigner ? » ; « Comment enseigner l’écriture inclusive à des élèves qui ne maitrisent pas bien les bases ou à des élèves qui profitent de ce flottement normatif ? » ; « Que faire de l’accord de proximité, du point médian et de l’ajout du X pour les personnes non binaires ? » ; « Que faire du iel ? » ; « Comment lire à haute voix ces textes ? » … En somme, comment tenir compte à la fois des injonctions en œuvre dans le contexte scolaire et de celles qui traversent la société (et de leur relative et apparente contradiction) ?
3La présente contribution vise à expliciter les enjeux sous-jacents à la prise en compte de deux recommandations de la Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique (CIIP)2, l’adoption de l’orthographe rectifiée et l’introduction d’une écriture inclusive, et à étudier la place de ces deux objets au sein d’un enseignement visant la connaissance et la compréhension du système et du fonctionnement de la langue parlée et écrite. En dialoguant avec des textes récents de linguistes et de didacticien·nes3 qui ont pris part au débat sur ces questions (Abeillé & al. 2023 ; Dister & Moreau 2020 ; Elmiger 2017 ; Gygax 2019 ; Manesse & Siouffi 2019 ; Roy 2022), elle formule des pistes pour la formation des enseignant·es qui respectent des principes de validité didactique (Bain & Schneuwly 1993), relatifs à l’enseignabilité des contenus choisis, à leur solidarité et leur cohérence d’ensemble et à leur pertinence par rapport aux capacités initiales des élèves, au milieu et au plan d’études, et de robustesse, à savoir en accord avec la recherche scientifique et les besoins du terrain (Kervyn 2020).
4Cette contribution présente les premières étapes d’une recherche-développement structurée, à savoir l’analyse préalable et la planification-production d’un dispositif didactique avant sa mise à l’essai, son évaluation et sa révision (Loiselle & Harvey 2007).
5Il s’agit d’abord de situer dans le contexte suisse romand, et de ses contraintes, la question de l’orthographe rectifiée et de l’écriture inclusive. Ce faisant, nous mettons en évidence le paradoxe de vouloir traiter conjointement ces deux objets. Si parler d’orthographe rectifiée montre une adaptation du système dans un contexte qui reste normatif, est-ce approprié de parler d’orthographe inclusive dans un contexte qui n’est pas (encore) normé et qui autorise beaucoup de liberté, voire de créativité (Alpheratz 2019) ? C’est un point qui nécessite d’être développé, car le corps enseignant4 cherche un cadre normé qui permette d’enseigner « les règles » et d’évaluer les textes d’élèves. Un des problèmes posés par l’écriture inclusive concerne la réalisation orale des énoncés écrits, lorsque certaines propositions en vue d’une écriture inclusive sont de l’ordre d’un système sémiotique qui n’a pas de réalisation orale, comme le X qui marque la non-binarité (Manesse 2019a ; 2021)5. De même, sur le plan orthographique, la pratique de l’accord de proximité, inévitable lorsqu’on parle d’écriture inclusive, crée des discordances dans le système des accords (Chervel 2019 ; Moreau 2019 ; Van Raemdonck 2019).
6Dans la deuxième partie du texte, nous exposons les difficultés terminologiques que posent ces deux nouveaux objets de formation. Nous montrons la variété des termes utilisés lorsqu’il est question d’écriture inclusive ou de langage épicène (Rabatel & Rosier 2019). Ces dénominations variées, révélatrices d’intentions, d’actions sur la langue qui ne sont pas identiques, génèrent des confusions chez les enseignant·es en demande de repères. Si l’on souhaite une terminologie opératoire et explicative (de Pietro 2014), quels choix de termes opérer pour rendre compte dans la formation initiale et continue des enseignant·es des transformations apportées par la prise en compte des rectifications et de l’écriture inclusive de la manière la plus modérée et optimale possible ?
7Ces réflexions autour de la distinction à apporter dans le traitement de l’orthographe rectifiée et de l’écriture inclusive, sans négliger leurs points de croisement, nous permettent, dans la troisième et dernière partie de ce texte, de dessiner des pistes de formation pour les enseignantes et les enseignants. Grâce au recensement et au classement de diverses pratiques (Dister & Moreau 2020 ; Elmiger 2017), nous détenons plus d’outils pour penser la didactisation de ces objets. Nous montrons comment le thème de l’écriture inclusive favorise une ouverture à un ensemble de pratiques scripturales présentes dans notre société et, surtout, comment il constitue un levier pour l’observation du fonctionnement de la langue. Prendre conscience des difficultés rencontrées dans la rédaction d’un texte en écriture inclusive est un excellent moyen de réfléchir à l’application d’un système orthographique fortement normé, tout en réfléchissant à la marge de manœuvre dont disposent les scriptrices et les scripteurs en fonction du contexte et à celle des enseignantes et enseignants, en vertu du cadre institutionnel.
2 | Entre identité et systématicité : des discours sur l’orthographe en tension
8Dans cette partie, nous retraçons brièvement les étapes qui ont mené à l’intégration de l’orthographe rectifiée dans les manuels scolaires recommandés. Puis, nous esquissons l’évolution des pratiques institutionnelles et des débats autour de l’écriture inclusive. En fin de partie, nous donnons un ensemble d’éléments permettant de mieux comprendre la conjoncture et les points de friction relatifs à ces deux objets.
2.1. L’entrée progressive de l’orthographe rectifiée dans les moyens d’enseignement romands
9En Suisse romande, c’est en 1996 que les rectifications orthographiques sont officiellement intégrées pour le français comme langue de scolarisation, par le biais d’une brochure largement diffusée dans les établissements scolaires. La brochure émane de la Délégation à la langue française, organe de la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP) qui a le rôle d’instance supracantonale en Suisse romande. Si les enseignant·es sont fortement encouragé·es à mettre en pratique les rectifications, rien n’est mis en place pour leur propre formation ; en outre, les manuels et ouvrages pour l’enseignement continuent d’adopter la graphie traditionnelle (Epars & Gagnon, 2022). Les rectifications restent au stade de la bonne intention et ne prennent pas racine dans les pratiques enseignantes : deux études faites en Suisse une dizaine d’années après l’introduction des rectifications de 1990 montrent que près de 90 % du personnel enseignant disent connaitre ces rectifications, mais que seuls 36 % les enseignent totalement ou partiellement (De Pietro et al. 2020)6. En 2021, lorsque la CIIP, organe politique responsable de l’édition des moyens recommandés pour la Suisse romande, annonce que les nouveaux moyens d’enseignement recommandés pour les trois cycles de l’école obligatoire seront rédigés en intégrant les rectifications, avec un démarrage en 2023, cela provoque de vives réactions politiques7. Des tentatives pour empêcher l’utilisation des rectifications dans les manuels d’enseignement fleurissent dans plusieurs cantons8. Néanmoins, les velléités de retour en arrière sont officiellement stoppées par les instances cantonales supérieures au début de l’année 2023. Les rectifications orthographiques pénètrent alors lentement les pratiques enseignantes et deviennent un objet incontournable dans la formation initiale et continue des enseignant·es.
2.2. L’écriture inclusive : un combat social
10Sur le plan des pratiques dites d’écriture inclusive – nous revenons sur ce terme dans la 2e partie du texte – le combat, tout aussi ardu, se livre dans d’autres sphères. Comme le montre Elmiger (2017), l’écriture dite « non sexiste » est appliquée en Suisse au niveau de la confédération, des cantons, de certaines villes et communes. Dans les médias, des prises de position fortes sont également observées : dès 2019, le quotidien Le Temps adopte une charte de l’égalité des genres, avec notamment la féminisation des noms de métiers et l’usage des doublets. Début 2021, la RTS (Radio Télévision Suisse) est l’un des premiers médias suisses romands à annoncer officiellement l’utilisation d’un « langage épicène et inclusif » dans ses communications tant orales qu’écrites9.
11Au niveau des institutions académiques, une volonté forte pour l’adoption d’un langage inclusif se manifeste de différentes manières depuis bientôt une décennie, avec une accélération ces trois dernières années : publication de guides internes, directives. L’EPFL10, institution phare du canton, a entrepris un projet d’implémentation du « langage inclusif » avec l’aide du chercheur fribourgeois Pascal Gygax. Dans ses communications, l’école polytechnique dit adopter 4 principes : 1) prédilection de formes épicènes ; 2) utilisation de doublets féminins-masculins lorsque les formes épicènes ne sont pas envisageables ; 3) recours à la forme contractée du doublet masculin-féminin avec le point médian en dernier recours, lorsque ni les formes épicènes ni les doublets ne sont possibles ; 4) adoption de la règle de proximité pour l’accord des déterminants, adjectifs et participes passés11. Au sein même de notre institution, la HEP Vaud, une directive12 incite à l’usage du « langage épicène dans toutes les communications institutionnelles » (Art. 1.1) pour « tenir compte de l’ensemble des destinataires des communications » (Art. 1.2). La directive mentionne aussi la volonté de « donner à l’ensemble des documents écrits de l’institution une base rédactionnelle commune et harmoniser les solutions variables actuellement employées » (Art.1.2) Notons que cette base rédactionnelle commune est en cours de mise à jour. Au sein de certaines institutions, le choix est même fait d’utiliser le féminin générique. L’Assemblée de l’Université de Neuchâtel a adopté des statuts entièrement féminisés13. L’association des Étudiantes en Médecine de Lausanne utilise également le féminin générique sur son site internet et dans ses statuts14. Ainsi, dans les institutions d’enseignement supérieur, les recommandations, les conseils, les guides foisonnent ; leurs contenus sont divers, à teneur variée et, surtout, n’ont pas force de loi. Libre à chacun·e de les appliquer.
12Dans l’enseignement obligatoire, le Petit livre d’OR recommande de sensibiliser les élèves « à une écriture qui s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes » (CIIP 2021 : 7). Y sont également précisés les points d’attention à prendre en compte, tant dans l’utilisation d’un « langage épicène », que dans le choix des textes utilisés. Ces recommandations apparaissent à la fin de la même brochure que celle qui énonce les principes de l’orthographe rectifiée.
13Cette évolution des pratiques ne va pas sans réactions du politique : tout comme l’orthographe rectifiée avait créé des réactions, l’écriture inclusive génère également des oppositions. En 2022, plusieurs motions ont été déposées pour lutter contre l’utilisation de l’écriture inclusive dans les textes administratifs officiels suisses15.
2.3. Orthographe rectifiée et écriture inclusive : une assimilation trompeuse
14L’orthographe rectifiée et l’écriture inclusive mobilisent la sensibilité des usagères et des usagers de la langue, car elles touchent des aspects identitaires (Rosier 2019). Malheureusement, la concordance temporelle de l’introduction de ces nouvelles pratiques dans le paysage scolaire et universitaire suisse romand provoque une assimilation trompeuse, qui fait perdre de vue les enjeux réels de ces évolutions. Si l’orthographe rectifiée a pour objectif de régulariser le système orthographique, l’écriture inclusive a pour objectif de proposer des usages langagiers plus égalitaires. Systématicité pour l’une, variations pour l’autre, ce qui ne permet pas de les traiter de la même manière. Pourtant, les médias suisses romands ne cessent d’alimenter les confusions. Le site de la RTS romande, par exemple, insiste sur l’exagération des réformes que la CIIP impose à l’école : « En plus de faire de la nouvelle orthographe la norme, la Conférence intercantonale de l'Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) veut sensibiliser les élèves à l'écriture inclusive »16. Autre exemple éloquent : l’éditorial du journal Lausanne Cités du 10 octobre 202117 évoque la « lubie » de l’écriture inclusive et conclut ainsi : « Mais que l’on ne s’y trompe pas, qu’elle soit épicène, inclusive ou rectifiée, l’orthographe promue par les mouvements militants ne dit pas son nom ». Dans le monde scolaire, cette confusion entre orthographe rectifiée et écriture épicène est grandement générée par la diffusion du Petit Livre d’OR de la CIIP. En effet, dans cette brochure, l’organisme justifie l’usage des rectifications dans les classes et conclut en donnant des recommandations aux enseignantes et aux enseignants au regard de l’écriture inclusive. Le choix de traiter simultanément ces deux objets dans une brochure officielle, qui fait office de référence commune pour l’enseignement en Suisse romande, peut contribuer à une mécompréhension de la part du corps enseignant de la distinction nécessaire à faire entre ces deux objets. Les deux principales parties de la brochure comprennent l’énoncé et l’explicitation des 14 principes de l’orthographe rectifiée et la formulation de « la règle d’or » pour l’écriture épicène : « Pour introduire un langage épicène à l’école, favorisons : des formulations qui respectent la diversité et assurent la visibilité des genres et des cultures ; des formulations qui ne rendent pas la compréhension, la lecture et les apprentissages plus difficiles » (p. 48). Des demandes de formation en établissement couplant ces deux thématiques nous parviennent d’ailleurs peu de temps après.
15Le Petit Livre d’OR contribue donc à la confusion entre deux objets très différents en matière de normativité. En effet, l’orthographe rectifiée suit des règles précises qui ne permettent ni la créativité ni les aménagements personnels. Elle fait partie d’un système tout aussi réglé que celui de l’orthographe traditionnelle. En revanche, l’écriture inclusive multiplie les propositions pour répondre à des impératifs de visibilisation des femmes et des personnes non binaires dans la langue, en vertu de considérations sociologiques et égalitaires. Cette variation dans les usages est reflétée par la multiplication des « guides » et autres « conseils d’utilisation » qui sont édités par chaque instance désireuse d’avoir une charte graphique cohérente. Ces différents usages peuvent être considérés comme normatifs à l’intérieur d’un contexte précis. Cependant, ils ne peuvent être condensés en une norme officielle à laquelle se référer, en raison de l’incompatibilité de certaines des propositions entre elles ou de l’inaccessibilité des autres. Cette absence de norme ne peut que déstabiliser, voire exclure (Klinkenberg, 2019), les usagers et les usagères de la langue, habitué·es à LA norme, notamment en ce qui concerne l’orthographe. Parler d’« orthographe inclusive » ou de « Grammaire pour un français inclusif18 » est d’ailleurs un peu irraisonnable, puisqu’il n’existe pas de règles précises, tant pour les questions morphologiques (faut-il utiliser le point médian pour faire apparaitre le genre féminin ? Si oui, comment ? Comment utiliser une marque non genrée comme le X ?) que pour celles liées à la syntaxe (faut-il utiliser l’accord de proximité ? Si oui, selon quelle logique ?). De telles appellations ne peuvent que déstabiliser les usagers et les usagères. Rosier (2019) relève que « ce qu’il y a de particulier avec l’écriture inclusive…c’est que même du point de vue des normes objectives, les linguistes ne sont pas en en accord (sur la manière d'envisager le neutre, le masculin générique ou le rapport oral/écrit) et que ses positions pro ou contra (rencontrent) les normes subjectives. » (p. 48). Des pratiques parallèles s’instaurent avec un flottement difficile à gérer et qui ne sera peut-être pas réglé (Siouffi 2019). Par conséquent, les enseignantes et les enseignants ne peuvent se référer à des règles communes partagées par toutes et tous, ce qui a comme conséquence de les désorienter dans leur pratique mononormée de l’enseignement de la langue. Bien qu’il soit possible pour la grammaire d’adopter des pratiques plurinormatives pour prendre en compte les variétés de français utilisées par les élèves ainsi que des enjeux sociaux qu’elles sous-tendent (Thibeault & Maynard 2022), les enseignant·es de français comme langue de scolarisation ont l’habitude, pour l’orthographe, de n’enseigner que la variété de français standard.
16Microcosme de la société, la formation des enseignantes et enseignants a son rôle à jouer dans ce débat sur l’écriture inclusive. Entre le discours scientifique, propre à la linguistique, et le discours militant, porteur de représentations sociales (Charaudeau 2019), le rôle de la didactique consiste précisément à orchestrer les discours en vue d’esquisser des compromis viables : « la réflexion de type épistémologique et historique sur la nature et la compatibilité des savoirs qui comptent pour l’enseignement-apprentissage de la langue revient au chercheur en didactique (Bronckart & Chiss 1990 : 34-35) ». Quel discours est recevable, admissible en formation ? Quel discours tenir, quelles activités mener pour former à enseigner l’orthographe du français aux élèves de demain ?
3 | Tensions terminologiques : quels choix de concepts opérer en formation ?
17Relativement à des objets « nouveaux », très peu abordés dans la formation des enseignant·es, quels choix de termes opérer pour outiller les enseignant·es à guider les observations des élèves, stimuler leurs réflexions sur la langue et les utiliser ? Dans le but de jeter les bases à un ensemble de propositions didactiques, nous proposons une sélection de termes clés à mobiliser en formation et justifions la pertinence de nos choix au vu des enjeux précédemment explicités.
3.1. Réforme et rectification
18Vis-à-vis des rectifications orthographiques, prescrites sur le territoire scolaire, il importe d’amener les étudiant·es à distinguer les termes de réforme et de rectification. En effet, les aménagements de 1990, centrés sur l’orthographe lexicale, ne concernent que 5000 mots de la langue française et ne constituent pas une réforme de l’orthographe. Retracer le parcours des principales étapes de l’Histoire de l’orthographe française peut aider le corps estudiantin à comprendre notamment que les différences entre l’oral et l’écrit en français tirent leur origine de la double filiation du français, romane et germanique, et que l’Académie a initialement opté pour une orthographe savante, latinisante et étymologique, qu’elle ajustera au cours des 18e et 19e siècles (Sprenger-Charolles & al. 2024). La contextualisation des rectifications dans l’évolution globale de l’orthographe permet de faire saisir aux étudiantes et étudiants qu’elles apportent plus de régularités, donnent une vision systémique de la langue et, de fait, facilitent l’apprentissage (Sprenger-Charolles & al. 2024).
3.2. Grammaire et norme
19En amont du traitement de ces deux objets, il peut être opportun de pointer les termes de grammaire et de norme. Hautement polysémique, le terme de grammaire est source de fréquentes confusions dans le discours de ceux qui l’utilisent (Combettes & Lagarde, 1982 ; Elalouf 2006 ; Gagnon & Bulea Bronckart 2017). Il désigne, d’un côté, les règles du système d’une langue et, de l’autre, la description, historiquement située, de ces mêmes règles (Chartrand 2013). C’est sur ce deuxième sens, celui de discours situé sur la langue, qu’il faut insister auprès du corps enseignant en formation au moment d’aborder la remarque sexiste de Vaugelas19. Il importe de montrer qu’il s’agit d’un discours qui appartient à une autre époque et que l’époque contemporaine n’autoriserait pas pareille assertion. Dans le but d’adopter une « pédagogie de la diversité », Le Petit Livre d’Or cite la règle « le masculin l’emporte sur le féminin »20 et demande qu’elle soit reformulée ainsi : « l’accord se fait au masculin » (CIIP 2021 : 51). On peut aussi expliciter que plusieurs linguistes ou femmes de lettres (cf. Dupuy et al. 2023 ; Abeillé & al. 2022 ; Viennot 2023) prônent l’application d’un accord de proximité, mais que cette stratégie de communication inclusive ne fait pas consensus, du moins chez les linguistes, dont certains argüent que cet accord s’inscrit « à rebours du système de l’accord et de son histoire » (OQLF 2018, cité dans Van Raemdonck 2019). La mise en exergue de ces débats permet de faire comprendre au public estudiantin les distinctions entre ce qui appartient à la règle (et au système de la langue) et ce qui tient du discours sur la langue.
20Parallèlement, cette réflexion terminologique intègre également la notion de norme. À l’instar de L. Rosier (2019), il peut être opportun de convoquer le modèle de l’Imaginaire linguistique développé par A.-M. Houdebine (2015) pour lier norme et rapports à la langue. La sociolinguiste propose une grille d’analyse qui « permet d’appréhender les différents facteurs à l’œuvre dans l’élaboration de la norme (…), et de catégoriser les différentes opinions émises par les locuteurs sur leur langue et sur les usages qu’ils en font » (Remysen, 2011 : 48). De manière simple, on peut amener les étudiants et étudiantes à distinguer ce qui relève des normes objectives et subjectives. Les premières « concernent la conformité des usages aux règles de la structure de la langue » et leur fréquence dans la langue. Les secondes appartiennent à « l’imaginaire linguistique proprement dit des locuteurs, qui se traduit par un ensemble d’attitudes » (Remysen : 48) ; elles se détaillent ainsi : normes évaluatives, normes fictives, normes prescriptives, normes identitaires, normes communicationnelles.
21Aborder la notion de norme relativement à l’écriture inclusive consiste à clarifier l’objectif à atteindre et les arguments linguistiques sur lesquels reposent nos choix. En effet, le but premier de l’écriture inclusive est de s’opposer à la norme du masculin générique et du « masculin qui l’emporte » (CIIP 2021). Tous les procédés proposés pour créer une écriture inclusive ont ainsi comme norme sous-jacente une norme prescriptive sur laquelle, par un phénomène d’opposition, ils viennent se construire. Ces nouveaux usages peuvent par ailleurs être considérés, dans un contexte donné, comme prescriptifs, car ils ont aussi leurs règles propres. Les guides que nous avons déjà évoqués plus haut, édités à l’usage du personnel de certaines institutions, témoignent de prescriptions qui n’ont pas pour objectif de fixer des pratiques déjà en place, mais de les diffuser. Cela explique que chaque institution édite ses propres prescriptions qui découlent de choix opérés à l’interne, plus ou moins clairs et opérationnels. C’est aussi ce que montre la Grammaire pour un français inclusif de Dupuy et al. (2023) qui recense les différents usages existants et « les techniques permettant de neutraliser ce sexisme21 » (p.7). Le combat féministe qui sous-tend l’ouvrage de Dupuy et al. est d’ailleurs revendiqué dès les premiers mots de l’introduction : « La langue est un lieu de pouvoir. Ses règles, ses mots, ses emplois offrent des indices pour savoir qui détient le pouvoir dans une société, qui obéit et qui résiste. Sa constitution reflète ses luttes » (p. 7). La particularité d’une telle grammaire est qu’elle n’est pas prescriptive au sens d’une norme commune : la communication inclusive y est vue comme un « coffre à outils qui permet de faire des choix différents et adaptés selon les contextes » (p. 77). Les procédés à disposition sont décrits comme se construisant sur la norme (par exemple « autrice » qui est une forme historique attestée) ou en s’inspirant de la norme (par exemple la création du nouveau terme neutre « locutaire » qui prend sa construction sur « destinataire »). Lorsque les procédés sont nouveaux comme l’utilisation du point médian, les pratiques sont également variées (séparation ou non des marques de genre féminin et de nombre : enseignant·e·s / enseignant·es), mais elles répondent tout de même à des règles : « Notez que lorsque le masculin se termine en -s, le signe typographique n’est pas doublé ; par exemple : les Français·es attentionné·e·s » (p. 141).
22On constate donc que si la variation est grande dans l’utilisation de l’écriture inclusive, celle-ci tend néanmoins à créer des micronormes internes au choix opéré par le locutaire22. Le glissement d’un usage marginal vers la norme s’opère par le biais des usagers et usagères : « la communauté linguistique est seule habilitée à trancher, qui par ses usages discursifs pourra influer sur les normes à venir » (Van Raemdonck 2019, 77). C’est ce que L. Rosier (2019), à la suite d’A.-M. Houdebine, appelle une norme systématique - par rapport à une norme systémique - c’est-à-dire une norme qui repose sur les usages et qui entre parfois en contradiction avec le système (la norme systémique).
3.3. Arbitraire et motivation du signe
23Le concept d’arbitrarité du signe est particulièrement éclairant pour aborder la notion de genre grammatical. En effet, si les opposant·es à l’écriture inclusive mettent en avant la distinction nécessaire entre le genre grammatical (interne à la langue, arbitraire) et le genre « naturel » (externe à la langue, biologique) pour défendre l’utilisation du masculin générique, les partisan·es d’une écriture inclusive valorisent la « propriété iconique » du genre masculin, laquelle ne peut être distinguée du genre social masculin (Alpheratz, 2019 ; Gygax 2019). Le masculin grammatical perd ainsi son caractère arbitraire et ne peut remplacer un genre neutre. Les propositions de création de formes neutres (autaire, froeure) bousculent fortement la norme et remettent en question l’arbitraire du signe en ce qui concerne le genre grammatical du masculin et du féminin. S’il peut être complexe de prendre position vis-à-vis de l’appellation du neutre ou d’une forme non marquée en français en formation23, la formulation des règles ne doit cependant pas être mise de côté (Dister & Moreau 2020). On peut ainsi oser interroger la notion d’arbitraire du signe en remettant en question l’utilisation des termes « masculin » et « féminin » pour désigner les genres grammaticaux (Chervel 2019). Une discussion sur le mot « masculin » et « féminin » peut être proposée aux étudiant·es afin de les rendre sensibles au caractère ambigu (arbitrarité vs motivation) des mots.
3.4. Écriture inclusive ou rédaction épicène ?
24Pour aborder les questions autour de « l’écriture inclusive » en formation, il est nécessaire de pointer la terminologie existante pour parler de ce phénomène langagier. Le foisonnement terminologique utilisé pour aborder les questions de l’inclusion se construit à la fois sur le nom (langage, écriture, français, rédaction, féminisation, etc.) et sur le complément qui lui est joint (épicène, inclusif, dégenré, non sexiste, etc.) avec toutes les combinaisons possibles : rédaction non sexiste (Elmiger 2019), langage ou rédaction épicène, langage dégenré (Rosier & Rabatel 2019), féminisation lexicale (Cerquiglini 2019), français inclusif (Alpheratz 2019), etc. Cela dit, toutes les dénominations n’ont pas le même objectif. Certaines font référence à la visibilisation de la femme dans la langue, à l’égalité entre hommes et femmes ou, encore, à l’effacement de la notion de genre. Les intentions portées par le choix d’une dénomination ne sont pas identiques et témoignent des combats politiques et sociaux sous-jacents portés par les mouvements féministes ou LGBTQIA+. Klinkenberg (2019) met en avant le fait que la langue est un moyen parmi d’autres de favoriser l’inclusion en visibilisant les femmes ou les personnes non binaires, l’objectif étant l’inclusion : « On voit donc que l’inclusion est un objectif, et qu’un des moyens tendant à produire cette inclusion est la visibilisation, certaines techniques assurant cette dernière étant langagières » (p.17). L’écriture inclusive s’intègre dans un combat qui « rencontre une problématique sociale, celle de la place des femmes dans la société et, au-delà, et souvent peu entendue, celle des personnes non-binaires. » (Rosier 2019 : 50). La formule « écriture inclusive » est ainsi un raccourci (Klinkenberg 2019 : 18). Les dénominations « écriture inclusive » et « langage épicène » ne désignent pas la même réalité.
25Dans les ouvrages récents sur la question (par exemple celui de Rosier & Rabatel 2019), la terminologie « écriture inclusive » est la plus répandue. Comme l’ont montré Manesse et Siouffi (2019), le terme « inclusif » désigne des procédés qui incluent, tout en les visibilisant, les différents genres ou la non-binarité (p.8). Au contraire, le terme « épicène » neutralise les distinctions et inclut les différents genres en gommant les différences. L’« épicénisation » est une hyperonymie de genre englobant tous les genres (Alpheratz 2019 : 58-63). La distinction entre « épicène » et « inclusif » est donc capitale. Comme il n’existe pas encore de consensus dans l’espace francophone pour désigner ces nouvelles formes d’écriture (Elmiger 2019), le choix du terme « écriture épicène » dans Le Petit livre d’Or de la CIIP (2021) pour de surcroit « assurer la visibilité des genres et des cultures » nous interroge.
26Il nous semble plus pertinent d’opter, en formation, pour le terme d’« écriture inclusive », tout en prenant soin de distinguer ce qui relève de l’inclusif ou de l’épicène, et de le définir de la manière suivante : « un ensemble d’attentions éditoriales qui permettent d’assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes » (Haddad 2023 : 19). Cette définition, tirée d’un ouvrage de vulgarisation, a le mérite de mettre en avant la norme communicationnelle évoquée plus haut, c’est-à-dire l’utilisation, dans un contexte donné, de pratiques d’écriture qui ont pour objectif de visibiliser autant les femmes que les hommes. Dans un contexte de formation inclusif, il faudrait y ajouter les personnes non genrées. Comme les phénomènes inclusifs ne se limitent pas à l’écrit, il est alors possible de parler de « français inclusif » pour inclure les phénomènes liés à la langue parlée, comme le fait Alpheratz (2019). Toutefois, nous gardons la dénomination « écriture inclusive » en formation, afin de mettre l’accent sur les procédés liés à l’écriture.
4 | Pistes de formation
27L’arrivée de ces deux objets en formation (orthographe rectifiée et écriture inclusive) permet d’aborder de manière nouvelle des phénomènes de langue et d’entrer dans une démarche d’articulation. Ces pratiques, comme nous l’avons dit plus haut, prennent appui sur les ressources internes de la langue. Les montrer permet ainsi de revenir à la norme objective et d’en avoir une compréhension plus approfondie.
28La didactisation de ces objets requiert l’identification, le classement de diverses unités en fonction de l’angle d’analyse de la langue qu’elles sous-tendent (Bulea Bronckart 2021). Sur la base de corpus comprenant divers exemples d’extraits ou de textes, il s’agit d’amener les étudiant·es à situer le phénomène observé sur le plan de l’analyse du lexique ou de l’orthographe, de la syntaxe, de la sémantique ou du texte. Il est aussi possible de proposer des exercices de transformation de textes en fonction de consignes qui intègrent des points de vue, des destinataires, des contextes communicatifs différents. On contribue ainsi à objectiver le rapport à la langue des futur·es enseignant·es et on les outille à situer les différents débats soulevés par ces deux nouveaux objets.
29Parallèlement, au sein même de notre institution, ces nouveaux objets conduisent à accorder plus de place à la variation dans la formation des enseignant·es de français langue première, formation marquée par le mononormatisme, fruit d’« une conception homogénéisante de l’école et des élèves, soucieuse de ne pas créer de différences, susceptibles d’induire des inégalités » (Bertucci & Castelotti 2012 : 200).
4.1. Des activités pour situer l’angle d’analyse de la langue : identifier, classer, transformer
30Lors de l’étude du lexique, l’écriture inclusive met en exergue des phénomènes de dérivation et de création lexicale. L’abord de la morphologie flexionnelle constitue un moment clé pour thématiser l’éventualité de marques morphologiques non genrées (amiX, curieuZ, chAErs). On peut en profiter pour s’intéresser à la création de néologismes sur la base de marques épicènes (copaine, locutaire,) ou à un élargissement possible du système des pronoms (iel / celleux). Les termes génériques et spécifiques s’intègrent dans ce pointage sur le lexique : le corpus proposé permettra d’identifier des mots qui renvoient au collectif (droits humains vs droits de l’Homme) ou au conceptuel (par exemple la différence entre la fonction et la personne) (Charaudeau 2019).
31Sur le plan discursif, il importe de proposer des exemples où, selon le contexte ou la situation, en fonction de l’intention de l’auteur ou de l’autrice, tel procédé est utilisé au détriment de tel autre. Le corpus choisi permet de faire observer des contextes où le dédoublement des éléments variables (doublets intégraux, doublets abrégés) est possible ou non. Il montre divers choix de signes typographiques (point médian, tiret, parenthèses, crochets, barre oblique) et divers ordres dans les unités doublées : féminin en premier, masculin en premier, ordre alphabétique. Ces choix créent des effets de sens et facilitent ou non la lecture. Le corpus intègre aussi des procédés de réduction de la variation (neutralisation), de manière à pouvoir échanger autour de l’interprétation qui en résulte de la part du destinataire (Elmiger, 2017). Des exemples de mémoires d’étudiant·e qui revendiquent une écriture identitaire peuvent illustrer l’usage de marques agenres (utilisation du X).
32Par exemple, ce mémoire de master récent produit par une étudiante en études genres à l’Université de Genève :
Pour ce travail, j’ai choisi de ne pas utiliser l’écriture inclusive avec point médian, mais, comme c’est souvent pratiqué dans certains milieux militants, de rajouter un « x » entre la forme féminine et la forme masculine, le « x » pouvant représenter toute personne ne se reconnaissant pas dans les formes binaires masculines ou féminines (Heussi 2023 : 1).
33Ou l’introduction de ce mémoire d’un étudiant au master en enseignement secondaire à la HEP Vaud :
Et lorsqu’iels rédigent, les difficultés apparaissent généralement d’une façon encore plus nette. Pour l’enseignant·e·x3, les défis pédagogiques sont considérables. (Détail de la note 3 : « En l’absence de normes clairement établies au sujet de l’écriture inclusive, je recours à une formule particulière. En utilisant le point médian de manière à faire comprendre que le genre masculin est aussi pris en compte, je donne à lire un texte au féminin inclusif ») (Masson 2024 : 4).
34L’écriture inclusive est ainsi montrée aux étudiant·es comme résultant d’une construction sur la base d’une norme commune (norme prescriptive), mais également comme répondant à des normes communicationnelles et identitaires.
35On peut penser ensuite demander de neutraliser certaines affirmations, à l’instar d’exemples tirés de l’ouvrage de Dupuy et al. (2023) :
| Les directrices et directeurs ont émis une nouvelle directive. | La direction a émis une nouvelle directive. |
| Les vieux et les vieilles devraient savoir utiliser ChatGPT. | Les personnes âgées devraient savoir utiliser ChatGPT. |
36Des exercices de transformation de textes peuvent être proposés aux étudiant·es. Par exemple, l’étudiant·e réécrit un règlement de classe qui utilise le mot « élève » au singulier, en mettant en évidence son caractère épicène tout en visibilisant les deux genres (un·e). C’est l’occasion de travailler sur le fonctionnement de la langue, en repérant les classes de mots, ou sur le marquage de l’accord en genre ou en nombre. Dans cet exercice de transformation de textes, où le pronom « iel » est employé, il s’agira de choisir les accords en conséquence dans un souci de cohésion et de cohérence textuelle.
37Cet ensemble d’activités sert à ce que les étudiant·es prennent conscience que, en tant qu’usagers et usagères de la langue, ils·elles décident de la norme et des écarts à celle-ci à utiliser, en adéquation au contexte concerné. En amont de ces exercices, il importe d’échanger autour de la norme commune que doit transmettre l’école.
38La question de l’accès à la lecture doit aussi être abordée en formation à l’enseignement. Indéniablement, certains procédés de l’écriture inclusive comme le point médian et la visibilisation des marques d’accord accroissent les difficultés de lecture dans la mesure où les marques qui ne transcrivent aucun son sont démultipliées, ce qui questionne son utilisation en classe ; pour autant, ne pas l’aborder risque de créer un certain élitisme autour de l’écriture inclusive (Manesse 2019b).
4.2. Autour de l’accord de proximité
39La question de l’accord de proximité, sujet à débat chez les linguistes, peut permettre de soulever des controverses auprès des (futur·es) enseignant·es. Comme nous l’avons dit plus haut, si d’un côté l’orthographe rectifiée a comme objectif de régulariser le système, l’écriture inclusive tend à multiplier les sous-systèmes : l’accord de proximité peut se combiner avec le choix d’utiliser l’ordre alphabétique ou de privilégier le féminin en premier (les agriculteurs et les agricultrices impliquées / les agricultrices et les agriculteurs impliqués). Les pratiques d’écriture inclusive permettent d’aborder l’accord de l’adjectif, du participe passé, du pronom et du déterminant.
40Quel discours tenir en formation vis-à-vis de l’utilisation de l’accord de proximité dans la pratique professionnelle de la personne en formation ? Au vu des connaissances parcellaires des étudiant·es en formation du système des accords en français (David & Rinck 2021; Monballin & Legros 2001), au vu de leurs difficultés, corolaires, rencontrées lorsqu’ils ou elles analysent les copies d’élèves pour en identifier les erreurs et proposer des interventions adaptées (Lefrançois & Montesinos-Gelet 2005 ; Péret, Sautot & Brissaud, 2008), il nous semble plus valide didactiquement de ne pas encourager l’application de l’accord de proximité, afin d’éviter de brouiller davantage le système mis en place. Aussi, au-delà d’activités d’observation ou d’analyse, ce type d’accord lié à l’orthographe grammaticale ne devrait pas être valorisé dans la pratique professionnelle. Nous voilà donc directement confrontées à cette « didactique de la contradiction ».
41Selon nous, l’économie est l’argument clé à fournir en formation pour se situer dans ce débat houleux. Si, d’un côté, l’accord de proximité permet de s’écarter précisément de la règle du « masculin l’emporte », de l’autre, il soulève le problème de l’évaluation du texte d’élève qui utiliserait tantôt une pratique, tantôt l’autre (même sans en avoir conscience). La règle d’accord traditionnelle, « l’accord de l’apport avec son support » (Van Raemdonck 2019 : 929), fortement ancrée dans les pratiques scolaires, a le grand mérite de donner un cadre qui évite l’anarchie dans la cohésion du texte et dans la compréhension des apprenant·es, qu’ils·elles soient futur·es enseignant·es ou élèves.
4.3. Désacraliser les règles d’accord des participes passés
42En lien avec les rectifications de 1990 et leur caractère systémique, il peut être intéressant, en formation à l’enseignement du secondaire, de s’arrêter aux règles du participe passé pour débattre autour des possibilités de simplifier et de rationaliser les règles. Sachant que l’attirail des règles d’accord du participe passé est prévu dans le programme du premier cycle du secondaire, connaissant aussi le temps investi à l’enseignement de ces règles, il peut être pertinent de mener des discussions autour de leur adéquation. À l’aide d’exemples de cas particuliers tels que Les airs qu’il a entendu/s chanter24 ou Les cent dollars que ces chaussures t’ont couté25 ou encore La place était plus grande qu’elle ne l’avait supposé26, il est possible de rappeler quelques cas particuliers pour faire prendre conscience aux étudiant·es de l’étendue de la complication de la règle d’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir. On peut ensuite expliciter les récentes propositions belges27 ou s’appuyer sur les propositions de Georges Legros (2024) et mener un débat sur l’intérêt ou non d’une rationalisation des règles. L’idée est d’amener le futur ou la future enseignante à interroger le sens et la portée de ces règles au vu de l’apprentissage de la langue chez les élèves en intégrant une réflexion sur le développement du rapport à l’écrit de l’élève. On participe ainsi à changer les représentations et, qui sait, les pratiques d’enseignement.
5 | Conclusion
43En partant du « Petit livre d’OR », édicté par la CIIP et référence commune aux enseignant·es de français en Suisse romande, nous avons voulu montrer que la question des normes, sous-jacente aux deux objets traités par cette brochure, à savoir l’orthographe rectifiée et l’écriture inclusive, ne peut être traitée de la même manière. Si l’on peut bien parler de norme commune pour l’orthographe rectifiée, on ne peut parler d’une norme partagée pour l’écriture inclusive. Cette différence fondamentale n’est souvent pas perçue par les usagers et les usagères et une confusion du traitement de ces deux objets se retrouve dans les demandes et les questionnements des (futur·es) enseignant·es. En formation (initiale ou continue) à l’enseignement, une distinction claire doit être faite dans le traitement didactique de l’orthographe rectifiée et celui de l’écriture inclusive.
44L’utilisation de l’orthographe rectifiée dans l’enseignement n’est maintenant plus sujette à débat puisqu’elle est officiellement intégrée à l’enseignement dès 2023 et que les manuels scolaires commencent peu à peu à être édités en tenant compte des rectifications. En formation, l’orthographe rectifiée permet de réfléchir au système de la langue et aux possibilités d’uniformisation de ce même système, légèrement touché par les rectifications de 1990, mais qui mériterait une régularisation bien plus radicale. Aborder avec les étudiant·es les irrégularités du système (par exemple l’accord du participe passé) est un moyen de désacraliser ces cas particuliers et de les encourager à se focaliser sur les régularités avec leurs élèves.
45Pour l’écriture inclusive, montrer l’éventail des pratiques permet de réfléchir, avec les (futur·es) enseignant·es, tout à la fois à l’impact de ces pratiques (des plus discrètes aux plus militantes) (Haddad, 2023) et à leur cout cognitif (Dister & Moreau 2020). Les positions personnelles peuvent être militantes, mais elles doivent être distinguées des pratiques enseignantes. De même, « point n’est besoin d’accepter toutes ses recettes [de l’écriture inclusive] pour adhérer au principe » (Van Raemdonck 2019 : 88).
46Alors, quelle norme préconiser aux (futur·es) enseignant·es en classe pour l’utilisation de l’écriture inclusive ? Si l’on s’en tient aux recommandations de la CIIP et de son « Petit livre d’OR », l’objectif pour les enseignant·es est de « sensibiliser nos élèves à une écriture qui s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes » et de les initier à une écriture qui respecte les genres (p.7). Concrètement, l’accent est mis sur une double contrainte : respecter « la diversité et assurer la visibilité des genres et des cultures » tout en adoptant des « formulations qui ne rendent pas la compréhension, la lecture et les apprentissages plus difficiles » (p. 49). La visibilisation des genres est encouragée non seulement par les pratiques langagières, mais également par les thématiques abordées lors des lectures. Il est explicitement demandé de ne pas utiliser le point médian ou le trait d’union dans les consignes pour les élèves et de faire l’accord des adjectifs au masculin pour les ensembles grammaticaux mixtes (on le voit, la possibilité de l’accord de proximité n’est pas retenue). Si les élèves doivent être sensibilisés aux questions d’égalité, notamment par un travail sur la langue, l’évaluation ne doit pas porter sur « l’écriture épicène » (p. 51). Ce cadre, à la fois large et précis sur certains points permet, selon nous, de régler les pratiques enseignantes.
47Néanmoins, cela ne guide pas les enseignant·es sur l’attitude à adopter face aux usages de l’écriture inclusive dans les productions des élèves. Nous encourageons les enseignant·es à montrer à leurs élèves les difficultés que pose une écriture inclusive en matière d’uniformité et d’accords. Étant donné que les questions autour de l’accord de proximité ou du genre neutre engendrent de vifs débats parmi les spécialistes, il nous semble évident que nous ne pouvons les utiliser avec les élèves, à moins d’en faire un sujet de débat ou d’observation de la langue.
48En définitive, entre la volonté de régularisation du système portée par l’orthographe rectifiée et la complexification induite par l’écriture inclusive qui multiplie les normes (Pahud & Singy 2023), c’est à l’enseignante, à l’enseignant de concilier la transmission d’une norme scolaire et celle d’une langue évolutive, reflet des usages d’aujourd’hui.
49La robustesse de nos propositions didactiques découle de leur expérimentation dans la formation et dans les classes. Il nous faut maintenant examiner comment les enseignant·es s’emparent de ces objets au moment d’aborder l’orthographe avec leurs élèves. Ce sont là les étapes futures de ce projet de recherche que nous entamerons auprès des étudiant·es inscrit·es au master secondaire I et II.
- 1 Dans ce texte, nous recourons volontairement à différents procédés inclusifs, comme c’est le cœur de notre propos. Nous les déployons et explicitons au fur et à mesure de l’avancée du texte. Ici, l’utilisation du doublet nous permet de rendre le lectorat attentif aux deux genres, tout en évacuant la problématique de l’accent grave qui est plus compliqué à utiliser avec le point médian.
- 2 Dans le système fédéraliste suisse, les questions liées à l’éducation sont déléguées aux autorités des différents cantons. Néanmoins, afin d’harmoniser au mieux les décisions en lien avec l’école, une instance supracantonale, la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP) a été créée. Le plan d’étude romand (PER), élaboré sous l’égide de la CIIP en 2010, constitue la base de référence de tout l’enseignement en Suisse romande ; il mentionne les rectifications, mais ne les impose pas en tant qu’objet d’enseignement. En 2021, la CIIP annonce officiellement l’utilisation de l’orthographe rectifiée dans les nouveaux manuels à venir et leur application généralisée dès 2023 (sans toutefois pénaliser chez les élèves l’usage de l’orthographe traditionnelle) (Epars & Gagnon, 2022).
- 3 L’utilisation du point médian nous permet de réduire le nombre de signes utilisés. Une question reste en suspens : faut-il ou non séparer la marque de genre de la marque du pluriel (didacticien·ne·s) ? Pour visibiliser le genre, nous préfèrerions utiliser le double point médian, mais pour des questions de simplicité, nous faisons le choix, dans cette communication, de ne pas séparer la marque du féminin de celle du pluriel.
- 4 L’utilisation d’un nom collectif montre que la distinction de genre n’est pas pertinente et renforce le caractère généralisé du propos.
- 5 Les propos de Manesse pourraient ici être nuancés dans la mesure où, en vertu du plurisystème du français (Catach 1980), les graphèmes n’ont pas nécessairement de réalisation orale.
- 6 L’enquête montrait également que 70% des enseignant·es comptaient juste lorsque leurs élèves utilisaient une variante rectifiée, parfois sans commentaire particulier (30%), parfois en attirant leur attention sur le mot concerné, alors que 7% considéraient l’usage de l’OR comme faux. 23% reconnaissaient ne pas être certain·es de les distinguer.
- 7 La lectrice ou le lecteur pourra, par exemple, lire la prose du Parti Libéral Radical à l’égard de cette « simplification de la langue française » à l’adresse suivante : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/21_INT_88_TextesCE.pdf.
- 8 Par exemple, dans le canton de Genève, après une pétition en ligne lancée par un parti de droite et qui a récolté un peu plus de 5 000 signatures, une motion est déposée au Grand Conseil (organe législatif cantonal) pour suspendre la décision de la CIIP et la soumettre à consultation (Epars & Gagnon 2022).
- 9 https://binary.rts.ch/entreprise/a-propos/2021/document/27456055.html/BINARY/ Externe_Langage+inclusif+RTS_1.pdf
- 10 École polytechnique fédérale de Lausanne.
- 11 https://www.epfl.ch/about/equality/fr/langage-inclusif/guide/principes/
- 12 Il s’agit de la directive 00_14. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/comite-direction/directives/directive-00-14-respectprincipeegalite-2015-hep-vaud.pdf
- 13 https://www.unine.ch/epicene/home/unine/statuts-feminin.html
- 14 https://aeml.ch/feminin/
- 15 Par exemple, la motion centriste déposée à Berne en juin 2022 qui affirme que « l’écriture inclusive ou le langage épicène ne devraient pas être utilisés au sein de l'administration fédérale » et qu’il faudrait « s’en tenir aux règles de l’Académie française dans l’administration fédérale » (https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/ 2022/20220607174143384194158159038_bsf144.aspx).
- 16 https://www.rts.ch/info/suisse/12264991-lecriture-inclusive-encouragee-dans-les-ecoles-romandes.html
- 17 https://lausannecites.ch/le-journal/eclairage/la-contre-attaque-sorganise-contre-lecriture-inclusive
- 18 Nous faisons référence au titre de l’ouvrage de Dupuy et al. (2023) qui, malgré son titre, contribue à alimenter de manière étoffée les débats.
- 19 « Le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer chaque fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble » (Vaugelas, 1647).
- 20 Chervel a montré que cette règle, malgré sa grande popularité, était absente « de la plupart des ouvrages de grammaire française, depuis les manuels scolaires jusqu’aux traités les plus savants » (2019 : 79).
- 21 Nous revenons dans la partie 2.4 à la question du combat politique ou social.
- 22 Par ailleurs, les autrices de cette grammaire montrent dans leur préambule à leur deuxième édition l’évolution rapide des usages en matière d’écriture inclusive : ce qui était marginal il y a quelques années (par exemple les formes tronquées comme lectrice·teur) est devenu courant depuis, tout du moins au Québec.
- 23 Les linguistes ne s’accordent pas sur l’existence d’une forme neutre en français. Chervel (2019) préfère parler d’une forme sous-entendue, alors que Surcouf (2024) n’hésite pas à y recourir pour analyser les usages des participes passés dans le français parlé. Van Raemdonck (2019) opte pour le terme de forme non marquée.
- 24 L’usage veut que le participe passé conjugué avec avoir s’accorde lorsque le complément d’objet direct se rapporte à la forme conjuguée et qu’il reste invariable lorsque le complément d’objet direct se rapporte à l’infinitif. Dans l’exemple proposé, l’arrêté du 28 décembre 1976 admet l’accord comme il s’agit d’un verbe de sensation et que « le verbe à l’infinitif s’interprète aussi comme l’objet de la forme participiale (on ne peut entendre chanter un air d’opéra sans entendre l’air d’opéra lui-même) » (Riegel & al. 1993 : 351).
- 25 Ici, comme le verbe couter est utilisé au sens propre, il exprime une valeur et est intransitif, d’où l’absence d’accord. L’exemple est tiré du site alloprof, « Les cas particuliers d’accord du participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir », https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-participe-passe-cas-particuliers-f1687.
- 26 Le pronom l’ reprend l’entier de la proposition qui a pour fonction d’être complément d’objet direct. Il est assimilable à cela, ce qui induit l’accord du participe passé au masculin singulier.
- 27 Conseil de la langue française et de la politique linguistique (2013). Pour une réforme de l’accord du participe passé (PP). En ligne : http://participepasse.info/